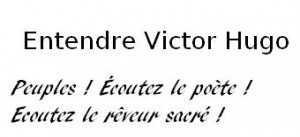La rose de l’infante
La rose de l’infante – Les références
La Légende des siècles – Première série – IX – La Rose de l’infante ;
Collection Bouquins, Robert Laffont, Œuvres complètes de Victor Hugo – Poésie II, p 755.
Autre référence : Collection Poésie/Gallimard, La Légende des siècles, p. 510.
La rose de l’infante – L’enregistrement
Je vous invite à écouter La rose de l’infante, un poème de La Légende des siècles – Première Série, IX – La Rose de l’infante, de Victor Hugo.
La rose de l’infante
La rose de l’infante – Le texte
La rose de l’infante
Elle est toute petite ; une duègne la garde.
Elle tient à la main une rose et regarde.
Quoi ? que regarde-t-elle ? Elle ne sait pas. L’eau,
Un bassin qu’assombrit le pin et le bouleau ;
Ce qu’elle a devant elle ; un cygne aux ailes blanches,
Le bercement des flots sous la chanson des branches,
Et le profond jardin rayonnant et fleuri ;
Tout ce bel ange a l’air dans la neige pétri.
On voit un grand palais comme au fond d’une gloire,
Un parc, de clairs viviers où les biches vont boire,
Et des paons étoilés sous les bois chevelus.
L’innocence est sur elle une blancheur de plus ;
Toutes ses grâces font comme un faisceau qui tremble.
Autour de cette enfant l’herbe est splendide et semble
Pleine de vrais rubis et de diamants fins ;
Un jet de saphirs sort des bouches des dauphins.
Elle se tient au bord de l’eau ; sa fleur l’occupe ;
Sa basquine est en point de Gênes ; sur sa jupe
Une arabesque, errant dans les plis du satin,
Suit les mille détours d’un fil d’or florentin.
La rose épanouie et toute grande ouverte,
Sortant du frais bouton comme d’une urne verte,
Charge la petitesse exquise de sa main ;
Quand l’enfant, allongeant ses lèvres de carmin,
Fronce, en la respirant, sa riante narine,
La magnifique fleur, royale et purpurine,
Cache plus qu’à demi ce visage charmant,
Si bien que l’œil hésite, et qu’on ne sait comment
Distinguer de la fleur ce bel enfant qui joue,
Et si l’on voit la rose ou si l’on voit la joue.
Ses yeux bleus sont plus beaux sous son pur sourcil brun.
En elle tout est joie, enchantement, parfum ;
Quel doux regard, l’azur ! et quel doux nom, Marie !
Tout est rayon ; son œil éclaire et son nom prie.
Pourtant, devant la vie et sous le firmament,
Pauvre être ! elle se sent très-grande vaguement ;
Elle assiste au printemps, à la lumière, à l’ombre,
Au grand soleil couchant horizontal et sombre,
À la magnificence éclatante du soir,
Aux ruisseaux murmurants qu’on entend sans les voir,
Aux champs, à la nature éternelle et sereine,
Avec la gravité d’une petite reine ;
Elle n’a jamais vu l’homme que se courbant ;
Un jour, elle sera duchesse de Brabant ;
Elle gouvernera la Flandre ou la Sardaigne.
Elle est l’infante, elle a cinq ans, elle dédaigne.
Car les enfants des rois sont ainsi ; leurs fronts blancs
Portent un cercle d’ombre, et leurs pas chancelants
Sont des commencements de règne. Elle respire
Sa fleur en attendant qu’on lui cueille un empire ;
Et son regard, déjà royal, dit : C’est à moi.
Il sort d’elle un amour mêlé d’un vague effroi.
Si quelqu’un, la voyant si tremblante et si frêle,
Fût-ce pour la sauver, mettait la main sur elle,
Avant qu’il eût pu faire un pas ou dire un mot,
Il aurait sur le front l’ombre de l’échafaud.
La douce enfant sourit, ne faisant autre chose
Que de vivre et d’avoir dans la main une rose,
Et d’être là devant le ciel, parmi les fleurs.
Le jour s’éteint ; les nids chuchotent, querelleurs ;
Les pourpres du couchant sont dans les branches d’arbre ;
La rougeur monte au front des déesses de marbre
Qui semblent palpiter sentant venir la nuit ;
Et tout ce qui planait redescend ; plus de bruit,
Plus de flamme ; le soir mystérieux recueille
Le soleil sous la vague et l’oiseau sous la feuille.
Pendant que l’enfant rit, cette fleur à la main,
Dans le vaste palais catholique romain
Dont chaque ogive semble au soleil une mitre,
Quelqu’un de formidable est derrière la vitre ;
On voit d’en bas une ombre, au fond d’une vapeur,
De fenêtre en fenêtre errer, et l’on a peur ;
Cette ombre au même endroit, comme en un cimetière,
Parfois est immobile une journée entière ;
C’est un être effrayant qui semble ne rien voir ;
Il rôde d’une chambre à l’autre, pâle et noir ;
Il colle aux vitraux blancs son front lugubre, et songe ;
Spectre blême ! Son ombre aux feux du soir s’allonge ;
Son pas funèbre est lent comme un glas de beffroi ;
Et c’est la Mort, à moins que ce ne soit le Roi.
C’est lui ; l’homme en qui vit et tremble le royaume.
Si quelqu’un pouvait voir dans l’œil de ce fantôme
Debout en ce moment l’épaule contre un mur,
Ce qu’on apercevrait dans cet abîme obscur,
Ce n’est pas l’humble enfant, le jardin, l’eau moirée
Reflétant le ciel d’or d’une claire soirée,
Les bosquets, les oiseaux se becquetant entre eux,
Non : au fond de cet œil comme l’onde vitreux,
Sous ce fatal sourcil qui dérobe à la sonde
Cette prunelle autant que l’océan profonde,
Ce qu’on distinguerait, c’est, mirage mouvant,
Tout un vol de vaisseaux en fuite dans le vent,
Et, dans l’écume, au pli des vagues, sous l’étoile,
L’immense tremblement d’une flotte à la voile,
Et, là-bas, sous la brume, une île, un blanc rocher,
Écoutant sur les flots ces tonnerres marcher.
Telle est la vision qui, dans l’heure où nous sommes,
Emplit le froid cerveau de ce maître des hommes,
Et qui fait qu’il ne peut rien voir autour de lui.
L’armada, formidable et flottant point d’appui
Du levier dont il va soulever tout un monde,
Traverse en ce moment l’obscurité de l’onde ;
Le roi dans son esprit la suit des yeux, vainqueur,
Et son tragique ennui n’a plus d’autre lueur.
Philippe Deux était une chose terrible.
Iblis dans le Koran et Caïn dans la Bible
Sont à peine aussi noirs qu’en son Escurial
Ce royal spectre, fils du spectre impérial.
Philippe Deux était le Mal tenant le glaive.
Il occupait le haut du monde comme un rêve.
Il vivait : nul n’osait le regarder ; l’effroi
Faisait une lumière étrange autour du roi ;
On tremblait rien qu’à voir passer ses majordomes ;
Tant il se confondait, aux yeux troubles des hommes,
Avec l’abîme, avec les astres du ciel bleu !
Tant semblait grande à tous son approche de Dieu !
Sa volonté fatale, enfoncée, obstinée,
Était comme un crampon mis sur la destinée ;
Il tenait l’Amérique et l’Inde, il s’appuyait
Sur l’Afrique, il régnait sur l’Europe, inquiet
Seulement du côté de la sombre Angleterre ;
Sa bouche était silence et son âme mystère ;
Son trône était de piège et de fraude construit ;
Il avait pour soutien la force de la nuit ;
L’ombre était le cheval de sa statue équestre.
Toujours vêtu de noir, ce Tout-Puissant terrestre
Avait l’air d’être en deuil de ce qu’il existait ;
Il ressemblait au sphinx qui digère et se tait ;
Immuable ; étant tout, il n’avait rien à dire.
Nul n’avait vu ce roi sourire ; le sourire
N’étant pas plus possible à ces lèvres de fer
Que l’aurore à la grille obscure de l’enfer.
S’il secouait parfois sa torpeur de couleuvre,
C’était pour assister le bourreau dans son œuvre,
Et sa prunelle avait pour clarté le reflet
Des bûchers sur lesquels par moments il soufflait.
Il était redoutable à la pensée, à l’homme,
À la vie, au progrès, au droit, dévot à Rome ;
C’était Satan régnant au nom de Jésus-Christ ;
Les choses qui sortaient de son nocturne esprit
Semblaient un glissement sinistre de vipères.
L’Escurial, Burgos, Aranjuez, ses repaires,
Jamais n’illuminaient leurs livides plafonds ;
Pas de festins, jamais de cour, pas de bouffons ;
Les trahisons pour jeu, l’autodafé pour fête.
Les rois troublés avaient au-dessus de leur tête
Ses projets dans la nuit obscurément ouverts ;
Sa rêverie était un poids sur l’univers ;
Il pouvait et voulait tout vaincre et tout dissoudre ;
Sa prière faisait le bruit sourd d’une foudre ;
De grands éclairs sortaient de ses songes profonds.
Ceux auxquels il pensait disaient : Nous étouffons.
Et les peuples, d’un bout à l’autre de l’empire,
Tremblaient, sentant sur eux ces deux yeux fixes luire.
Charles fut le vautour, Philippe est le hibou.
Morne en son noir pourpoint, la toison d’or au cou,
On dirait du destin la froide sentinelle ;
Son immobilité commande ; sa prunelle
Luit comme un soupirail de caverne ; son doigt
Semble, ébauchant un geste obscur que nul ne voit,
Donner un ordre à l’ombre et vaguement l’écrire.
Chose inouïe ! il vient de grincer un sourire.
Un sourire insondable, impénétrable, amer.
C’est que la vision de son armée en mer
Grandit de plus en plus dans sa sombre pensée ;
C’est qu’il la voit voguer par son dessein poussée,
Comme s’il était là, planant sous le zénith ;
Tout est bien ; l’océan docile s’aplanit ;
L’armada lui fait peur comme au déluge l’arche ;
La flotte se déploie en bon ordre de marche,
Et, les vaisseaux gardant les espaces fixés,
Échiquier de tillacs, de ponts, de mâts dressés,
Ondule sur les eaux comme une immense claie.
Ces vaisseaux sont sacrés ; les flots leur font la haie ;
Les courants, pour aider ces nefs à débarquer,
Ont leur besogne à faire et n’y sauraient manquer ;
Autour d’elles la vague avec amour déferle,
L’écueil se change en port, l’écume tombe en perle.
Voici chaque galère avec son gastadour ;
Voici ceux de l’Escaut, voilà ceux de l’Adour ;
Les cent mestres de camp et les deux connétables ;
L’Allemagne a donné ses ourques redoutables,
Naples ses brigantins, Cadiz ses galions,
Lisbonne ses marins, car il faut des lions.
Et Philippe se penche, et, qu’importe l’espace !
Non-seulement il voit, mais il entend. On passe,
On court, on va. Voici le cri des porte-voix,
Le pas des matelots courant sur les pavois,
Les moços, l’amiral appuyé sur son page,
Les tambours, les sifflets des maîtres d’équipage,
Les signaux pour la mer, l’appel pour les combats,
Le fracas sépulcral et noir du branle-bas.
Sont-ce des cormorans ? sont-ce des citadelles ?
Les voiles font un vaste et sourd battement d’ailes ;
L’eau gronde, et tout ce groupe énorme vogue, et fuit,
Et s’enfle et roule avec un prodigieux bruit.
Et le lugubre roi sourit de voir groupées
Sur quatre cents vaisseaux quatre-vingt mille épées.
Ô rictus du vampire assouvissant sa faim !
Cette pâle Angleterre, il la tient donc enfin !
Qui pourrait la sauver ? Le feu va prendre aux poudres.
Philippe dans sa droite a la gerbe des foudres ;
Qui pourrait délier ce faisceau dans son poing ?
N’est-il pas le seigneur qu’on ne contredit point ?
N’est-il pas l’héritier de César ? le Philippe
Dont l’ombre immense va du Gange au Pausilippe ?
Tout n’est-il pas fini quand il a dit : Je veux !
N’est-ce pas lui qui tient la victoire aux cheveux ?
N’est-ce pas lui qui lance en avant cette flotte,
Ces vaisseaux effrayants dont il est le pilote
Et que la mer charrie ainsi qu’elle le doit ?
Ne fait-il pas mouvoir avec son petit doigt
Tous ces dragons ailés et noirs, essaim sans nombre ?
N’est-il pas lui, le roi ? n’est-il pas l’homme sombre
À qui ce tourbillon de monstres obéit ?
Quand Béit-Cifresil, fils d’Abdallah-Béit,
Eut creusé le grand puits de la mosquée, au Caire,
Il y grava : « Le ciel est à Dieu ; j’ai la terre. »
Et, comme tout se tient, se mêle et se confond,
Tous les tyrans n’étant qu’un seul despote au fond,
Ce que dit ce sultan jadis, ce roi le pense.
Cependant, sur le bord du bassin, en silence,
L’infante tient toujours sa rose gravement,
Et, doux ange aux yeux bleus, la baise par moment.
Soudain un souffle d’air, une de ces haleines
Que le soir frémissant jette à travers les plaines,
Tumultueux zéphyr effleurant l’horizon,
Trouble l’eau, fait frémir les joncs, met un frisson
Dans les lointains massifs de myrte et d’asphodèle,
Vient jusqu’au bel enfant tranquille, et, d’un coup d’aile,
Rapide, et secouant même l’arbre voisin,
Effeuille brusquement la fleur dans le bassin ;
Et l’infante n’a plus dans la main qu’une épine.
Elle se penche, et voit sur l’eau cette ruine ;
Elle ne comprend pas ; qu’est-ce donc ? Elle a peur ;
Et la voilà qui cherche au ciel avec stupeur
Cette brise qui n’a pas craint de lui déplaire.
Que faire ? Le bassin semble plein de colère ;
Lui, si clair tout à l’heure, il est noir maintenant ;
Il a des vagues ; c’est une mer bouillonnant ;
Toute la pauvre rose est éparse sur l’onde ;
Ses cent feuilles, que noie et roule l’eau profonde,
Tournoyant, naufrageant, s’en vont de tous côtés
Sur mille petits flots par la brise irrités ;
On croit voir dans un gouffre une flotte qui sombre.
« — Madame, dit la duègne avec sa face d’ombre
À la petite fille étonnée et rêvant,
Tout sur terre appartient aux princes, hors le vent. »