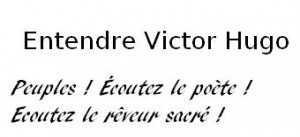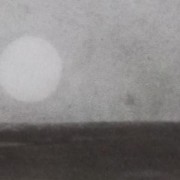L’Épopée du ver
L’Épopée du ver – Les références
La Légende des siècles – Nouvelle Série – XI. L’Épopée du ver ;
Collection Bouquins, Robert Laffont, Œuvres complètes de Victor Hugo, Poésie III, p 363.
Autre référence : Collection Poésie/Gallimard, La Légende des siècles – XIII. L’Épopée du ver, p. 225.
L’Épopée du ver – L’enregistrement
Je vous invite à écouter L’Épopée du ver, un poème du recueil La Légende des siècles – Nouvelle Série, de Victor Hugo.
L’Épopée du ver
L’Épopée du ver – Le texte
L’Épopée du ver
Au fond de la poussière inévitable, un être
Rampe, et souffle un miasme ignoré qui pénètre
L’homme de toutes parts,
Qui noircit l’aube, éteint le feu, sèche la tige,
Et qui suffit pour faire avorter le prodige
Dans la nature épars.
Le monde est sur cet être et l’a dans sa racine,
Et cet être, c’est moi. Je suis. Tout m’avoisine.
Dieu me paye un tribut.
Vivez. Rien ne fléchit le ver incorruptible.
Hommes, tendez vos arcs ; quelle que soit la cible,
C’est moi qui suis le but.
Ô vivants, je l’avoue, on voit des hommes rire ;
Plus d’une barque vogue avec un bruit de lyre ;
On est prince et seigneur ;
Le lit nuptial brille, on s’aime, on se le jure,
L’enfant naît, les époux sont beaux ; — j’ai pour dorure
Ce qu’on nomme bonheur.
Je mords Socrate, Eschyle, Homère, après l’envie.
Je mords l’aigle. Le bout visible de la vie
Est à tous et partout,
Et, quand au mois de mai le rouge-gorge chante,
Ce qui fait que Satan rit dans l’ombre méchante,
C’est que j’ai l’autre bout.
Je suis l’Inconnu noir qui, plus bas que la bête,
Remplit tout ce qui marche au-dessus de sa tête
D’angoisse et de terreur ;
La preuve d’Alecton pareille à Cléopâtre,
De la pourpre identique au haillon, et du pâtre
Égal à l’empereur.
Je suis l’extinction du flambeau, toujours prête.
Il suffit qu’un tyran pense à moi dans la fête
Où les rois sont assis,
Pour que sa volupté, sa gaîté, sa débauche,
Devienne on ne sait quoi de lugubre où s’ébauche
La pâle Némésis.
Je ne me laisse point oublier des satrapes ;
La nuit, lascifs, leur main touche à toutes les grappes
Du plaisir hasardeux,
Et, pendant que leurs sens dans l’extase frémissent,
Des apparitions de méduses blêmissent
La voûte au-dessus d’eux.
Je suis le créancier. L’échéance m’est due.
J’ai, comme l’araignée, une toile tendue.
Tout l’univers, c’est peu.
Le fil imperceptible et noir que je dévide
Ferait l’aurore veuve et l’immensité vide
S’il allait jusqu’à Dieu.
J’attends. L’obscurité sinistre me rend compte.
Le capitaine armé de son sceptre, l’archonte,
Le grave amphictyon,
L’augure, le poëte étoilé, le prophète,
Tristes, songent à moi, cette vie étant faite
De disparition.
Le vizir sous son dais, le marchand sur son âne,
Familles et tribus, les seigneurs d’Ecbatane
Et les chefs de l’Indus
Passent, et seul je sais dans quelle ombre est conduite
Cette prodigieuse et misérable fuite
Des vivants éperdus.
Brillez, cieux. Vis, nature. Ô printemps, fais des roses.
Rayonnez, papillons, dans les métamorphoses.
Que le matin est pur !
Et comme les chansons des oiseaux sont charmantes,
Au-dessus des amants, au-dessus des amantes,
Dans le profond azur !
*
Quand, sous terre rampant, j’entre dans Babylone,
Dans Tyr qui porte Ammon sur son double pylône,
Dans Suze où l’aube luit,
Lorsque entendant chanter les hommes, je me glisse,
Invisible, caché, muet, dans leur délice,
Leur triomphe et leur bruit,
Quoique l’épaisseur vaste et pesante me couvre,
Quoique la profondeur, qui jamais ne s’entr’ouvre,
Morne et sans mouvement,
Me cache à tous les yeux dans son horreur tranquille,
Tout, quel que soit le lieu, quelle que soit la ville,
Quel que soit le moment,
Tout, Vesta comme Églé, Zénon comme Épicure,
A le tressaillement de ma présence obscure ;
On a froid, on a peur ;
L’un frémit dans son faste et l’autre dans ses crimes,
Et l’on sent dans l’orgueil démesuré des cimes
Une vague stupeur ;
Et le Vatican tremble avec le Capitole,
Et le roi sur le trône, et sur l’autel l’idole,
Et Moloch et Sylla
Frissonnent, et le mage épouvanté contemple,
Sitôt que le palais a dit tout bas au temple :
Le ver de terre est là !
*
Je suis le niveleur des frontons et des dômes ;
Le dernier lit où vont se coucher les Sodomes
Est arrangé par moi ;
Je suis fourmillement et je suis solitude,
Je suis sous le blasphème et sous la certitude,
Et derrière Pourquoi.
Nul dogme n’oserait affronter ma réponse.
Laïs pour moi se frotte avec la pierre ponce.
Je fais parler Pyrrhon.
La guerre crie, enrôle, ameute, hurle, vole,
Et je suis dans sa bouche alors que cette folle
Souffle dans son clairon.
Je suis l’intérieur du prêtre en robe blanche,
Je bave dans cette âme où la vérité penche ;
Quand il parle, je mens.
Le destin, labyrinthe, aboutit à ma fosse.
Je suis dans l’espérance et dans la femme grosse,
Et, rois, dans vos serments.
Quel sommeil effrayant, la vie ! En proie, en butte
À des combinaisons de triomphe ou de chute,
Passifs, engourdis, sourds,
Les hommes, occupés d’objets qui se transforment,
Sont hagards, et devraient s’apercevoir qu’ils dorment,
Puisqu’ils rêvent toujours !
J’ai pour l’ambitieux les sept couleurs du prisme.
C’est moi que le tyran trouve en son despotisme
Après qu’il l’a vomi.
Je l’éveille, sitôt sa colère rugie.
Qu’est la méchanceté ? C’est de la léthargie ;
Dieu dans l’âme endormi.
Hommes, riez. La chute adhère à l’apogée.
L’écume manquerait à la mer submergée,
L’éclat au diamant,
La neige à l’Athos, l’ombre aux loups, avant qu’on voie
Manquer la confiance et l’audace et la joie
À votre aveuglement.
L’éventrement des monts de jaspe et de porphyre
À bâtir vos palais peut à peine suffire,
Larves sans lendemain !
Vous avez trop d’autels. Vos sociétés folles
Meurent presque toujours par un excès d’idoles
Chargeant l’esprit humain.
Qu’est la religion ? L’abîme et ses fumées.
Les simulacres noirs flottant sous les ramées
Des bois insidieux,
La contemplation de l’ombre, les passages
De la nue au-dessus du front pensif des sages,
Ont créé tous vos dieux.
Vos prêtres insensés chargent Satan lui-même
D’un dogme et d’un devoir, lui le monstre suprême,
Lui la rébellion !
Ils en font leur bourreau, leur morne auxiliaire,
Sans même s’informer si cette muselière
Convient à ce lion.
Pour aller jusqu’à Dieu dans l’infini, les cultes,
Les religions, l’Inde et ses livres occultes
Par Hermès copiés,
Offrent leurs points d’appui, leurs rites, leurs prières,
Leurs dogmes, comme un gué montre à fleur d’eau des pierres
Où l’on pose ses pieds.
Songes vains ! Les Védas trompent leurs clientèles,
Car les religions sont des choses mortelles
Qu’emporte un vent d’hiver ;
Hommes, comme sur vous sur elles je me traîne ;
Et, pour ronger l’autel, Dieu n’a pas pris la peine
De faire un autre ver.
*
Je suis dans l’enfant mort, dans l’amante quittée,
Dans le veuvage prompt à rire, dans l’athée,
Dans tous les noirs oublis.
Toutes les voluptés sont pour moi fraternelles.
C’est moi que le fakir voit sortir des prunelles
Du vague spectre Iblis.
Mon œil guette à travers les fêlures des urnes.
Je vois vers les gibets voler les becs nocturnes
Quêtant un noir lambeau.
Je suis le roi muré. J’habite le décombre.
La mort me regardait quand d’une goutte d’ombre
Elle fit le corbeau.
Je suis. Vous n’êtes pas, feu des yeux, sang des veines,
Parfum des fleurs, granit des tours, ô fiertés vaines !
Tout d’avance est pleuré.
On m’extermine en vain, je renais sous ma voûte ;
Le pied qui m’écrasa peut poursuivre sa route,
Je le dévorerai.
J’atteins tout ce qui vole et court. L’argiraspide
Ne peut me fuir, eût-il un cheval plus rapide
Que l’oiseau de Vénus ;
Je ne suis pas plus loin des chars qui s’accélèrent
Que du cachot massif où des lueurs éclairent
De sombres torses nus.
*
Un peuple s’enfle et meurt comme un flot sur la grève.
Dès que l’homme a construit une cité, le glaive
Vient et la démolit ;
Ce qui résiste au fer croule dans les délices ;
Pour te tuer, ô Rome, Octave a les supplices,
Messaline a son lit.
Tout ici-bas perd pied, se renverse, trébuche,
Et partout l’homme tombe, étant sa propre embûche ;
Pourtant l’humanité
Se lève dans l’orgueil et dans l’orgueil se couche ;
Et le manteau de poil du prophète farouche
Est plein de vanité.
Puisque ce sombre orgueil s’accroît toujours et monte,
Puisque Tibère est Dieu, puisque Rome sans honte
Lui chante un vil pœan,
Puisque l’austérité des Burrhus se croit vierge,
Puisqu’il est des Xercès qui prennent une verge
Et fouettent l’océan,
Il faut bien que le ver soit là pour l’équilibre.
Ce que le Nil, l’Euphrate et le Gange et le Tibre
Roulent avec leur eau,
C’est le reflet d’un tas de villes inouïes
Faites de marbre et d’or, plus vite évanouies
Que la fleur du sureau.
Fétide, abject, je rends les majestés pensives.
Je mords la bouche, et quand j’ai rongé les gencives,
Je dévore les dents.
Oh ! ce serait vraiment dans la nature entière
Trop de faste, de bruit, d’emphase et de lumière,
Si je n’étais dedans !
Le néant et l’orgueil sont de la même espèce.
Je les distingue peu lorsque je les dépèce.
J’erre éternellement
Dans une obscurité d’horreur et d’anathème,
Redoutable brouillard dont Satan n’est lui-même
Qu’un épaississement.
*
Tout me sert. Glaive et soc, et sagesse et délire.
De tout temps la trompette a combattu la lyre ;
C’est le double éperon,
C’est la double fanfare aux forces infinies ;
Le prodige jaillit de ce choc d’harmonies ;
Luttez, lyre et clairon.
Lyre, enfante la paix. Clairon, produis la guerre.
Mettez en mouvement cette tourbe vulgaire
Des camps et des cités ;
Luttez ; poussez les uns aux batailles altières,
Les autres aux moissons, et tous aux cimetières ;
Lyre et clairon, chantez !
Chantez ! le marbre entend. La pierre n’est pas sourde,
Les tours sentent frémir leur dalle la plus lourde,
Le bloc est remué,
Le créneau cède au chant qui passe par bouffée,
Et le mur tressaillant qui naît devant Orphée,
Meurt devant Josué.
*
Tout périt. C’est pour moi, dernière créature,
Que travaille l’effort de toute la nature.
Le lys prêt à fleurir,
La mésange au printemps qui dans son nid repose
Et qui sent l’œuf, cassé par un petit bec rose,
Sous elle s’entr’ouvrir,
Les Moïses emplis d’une puissance telle
Que le peuple, écoutant leur parole immortelle
Au pied du mont fumant,
Leur trouve une lueur de plus en plus étrange,
Tremble, et croit derrière eux voir deux ailes d’archange
Grandir confusément,
Les passants, le despote aveugle et sans limites,
Les rois sages avec leurs trois cents sulamites,
Les pâles inconnus,
L’usurier froid, l’archer habile aux escarmouches,
Les cultes et les dieux plus nombreux que les mouches
Dans les joncs du Cydnus.
Tout m’appartient. À moi symboles, mœurs, images !
À moi ce monde affreux de bourreaux et de mages
Qui passe, groupe noir,
Sur qui l’ombre commence à tomber, que Dieu marque,
Qu’un vent pousse, et qui semble une farouche barque
De pirates le soir.
À moi la courtisane ! À moi le cénobite !
Dieu me fait Sésostris afin que je l’habite.
En arrière, en avant,
À moi tout ! À toute heure, et qu’on entre ou qu’on sorte !
Ma morsure, qui va finir à Phryné morte,
Commence à Job vivant.
À moi le condamné dans sa lugubre loge !
Il regarde effaré les pas que fait l’horloge ;
Et, quoiqu’en son ennui
La Mort soit invisible à ses fixes prunelles,
À d’obscurs battements il sent d’horribles ailes
Qui s’approchent de lui.
Rhode est fière, Chéops est grande, éphèse est rare,
Le Mausolée est beau, le Dieu tonne, le Phare
Sauve les mâts penchés,
Babylone suspend dans l’air les fleurs vermeilles,
Et c’est pour moi que l’homme a créé sept merveilles,
Et Satan sept péchés.
À moi la vierge en fleur qui rit et se dérobe,
Fuit, passe les ruisseaux, et relève sa robe
Dans les prés ingénus !
À moi les cris, les chants, la gaîté qui redouble !
À moi l’adolescent qui regarde avec trouble
La blancheur des pieds nus !
Rois, je me roule en cercle et je suis la couronne ;
Buveurs, je suis la soif ; murs, je suis la colonne ;
Docteurs, je suis la loi ;
Multipliez les jeux et les épithalames,
Les soldats sur vos tours, dans vos sérails les femmes ;
Faites, j’en ai l’emploi.
Sage ici-bas celui qui pense à moi sans cesse !
Celui qui pense à moi vit calme et sans bassesse ;
Juste, il craint le remord ;
Sous son toit frêle il songe aux maisons insondables ;
Il voit de la lumière aux deux trous formidables
De la tête de mort.
Votre prospérité n’est que ma patience.
Hommes, la volonté, la raison, la science,
Tentent ; seul j’accomplis.
Toute chose qu’on donne est à moi seul donnée.
Il n’est pas de fortune et pas de destinée
Qui ne m’ait dans ses plis.
Le héros qui, dictant des ordres à l’histoire,
Croit laisser sur sa tombe un nuage de gloire,
N’est sûr que de moi seul.
C’est à cause de moi que l’homme désespère.
Je regarde le fils naître, et j’attends le père
En dévorant l’aïeul.
Je suis l’être final. Je suis dans tout. Je ronge
Le dessous de la joie, et quel que soit le songe
Que les poëtes font,
J’en suis, et l’hippogriffe ailé me porte en croupe ;
Quand Horace en riant te fait boire à sa coupe,
Chloé, je suis au fond.
La dénudation absolue et complète,
C’est moi. J’ôte la force aux muscles de l’athlète ;
Je creuse la beauté ;
Je détruis l’apparence et les métamorphoses ;
C’est moi qui maintiens nue, au fond du puits des choses,
L’auguste vérité.
Où donc les conquérants vont-ils ? mes yeux les suivent.
À qui sont-ils ? à moi. L’heure vient ; ils m’arrivent,
Découronnés, pâlis,
Et tous je les dépouille, et tous je les mutile,
Depuis Cyrus vainqueur de Tyr jusqu’à Bathylle
Vainqueur d’Amaryllis.
Le semeur me prodigue au champ qu’il ensemence ;
Tout en achevant l’être expiré, je commence
L’être encor jeune et beau.
Ce que Fausta, troublée en sa pensée aride,
Voit dans le miroir pâle où s’ébauche une ride,
C’est un peu de tombeau.
Toute ivresse m’aura dans sa dernière goutte ;
Et sur le trône il n’est rien à quoi je ne goûte.
Les Trajans, les Nérons
Sont à moi, honte et gloire, et la fange est épaisse
Et l’or est rayonnant pour que je m’en repaisse.
Tout marche ; j’interromps.
J’habite Ombos, j’habite Élis, j’habite Rome.
J’allonge mes anneaux dans la grandeur de l’homme ;
J’ai l’empire et l’exil ;
C’est moi que les puissants et les forts représentent ;
En ébranlant les cieux, les Jupiters me sentent
Ramper dans leur sourcil.
Je prends l’homme, ébauche humble et tremblante qui pleure,
Le nerf qui souffre, l’œil qu’en vain le jour effleure,
Le crâne où dort l’esprit,
Le cœur d’où sort le sang ainsi qu’une couleuvre,
La chair, l’amour, la vie, et j’en fais un chef-d’œuvre,
Le squelette qui rit.
*
L’eau n’a qu’un bruit ; l’azur n’a que son coup de foudre ;
Le juge n’a qu’un mot, punir, ou bien absoudre ;
L’arbre n’a que son fruit ;
L’ouragan se fatigue à de vaines huées,
Et n’a qu’une épaisseur quelconque de nuées ;
Moi, j’ai l’énorme nuit.
L’Etna n’est qu’un charbon que creuse un peu de soufre ;
L’erreur de l’Océan, c’est de se croire un gouffre ;
Je dirai : C’est profond,
Quand vous me trouverez un précipice, un piège,
Où l’univers sera comme un flocon de neige
Qui décroît et qui fond.
Quoique l’enfer soit triste, et quoique la géhenne
Sans pitié, redoutable aux hommes pleins de haine,
Ouverte au-dessous d’eux,
Soit étrange et farouche, et quoiqu’elle ait en elle
Les immenses cheveux de la flamme éternelle,
Qu’agite un vent hideux,
Le néant est plus morne encor, la cendre est pire
Que la braise, et le lieu muet où tout expire
Est plus noir que l’enfer ;
Le flamboiement est pourpre et la fournaise montre ;
Moi je bave et j’éteins. L’hydre est une rencontre
Moins sombre que le ver.
Je suis l’unique effroi. L’Afrique et ses rivages
Pleins du barrissement des éléphants sauvages,
Magog, Thor, Adrasté,
Sont vains auprès de moi. Tout n’est qu’une surface
Qui sert à me couvrir. Mon nom est Fin. J’efface
La possibilité.
J’abolis aujourd’hui, demain, hier. Je dépouille
Les âmes de leurs corps ainsi que d’une rouille ;
Et je fais à jamais
De tout ce que je tiens disparaître le nombre
Et l’espace et le temps, par la quantité d’ombre
Et d’horreur que j’y mets.
*
Amant désespéré, tu frappes à ma porte,
Redemandant ton bien et ta maîtresse morte,
Et la chair de ta chair,
Celle dont chaque nuit tu dénouais les tresses,
Plus fier, plus éperdu, plus ivre en ses caresses
Que l’aigle au vent de mer.
Tu dis : « — Je la veux ! Terre et cieux, je la réclame !
Le jour où je la vis, je crus voir une flamme.
Viens, dit-elle. Je vins.
Sa jeune taille était plus souple que l’acanthe ;
Elle errait éblouie, idéale bacchante,
Sous des pampres divins.
« Son cœur fut si profond que j’y perdis mon âme.
Je l’aimais ! quand le soir, les yeux de cette femme
Au front pur, au sein nu,
Me regardaient, pensifs, clairs, à travers ses boucles,
Je croyais voir briller les vagues escarboucles
D’un abîme inconnu.
« C’est elle qui prenait ma tête en ses mains blanches !
Elle qui me chantait des chansons sous les branches,
Des chansons dans les bois,
Si douces qu’on voyait sur l’eau rêver le cygne,
Et que les dieux là-haut se faisaient entr’eux signe
D’écouter cette voix !
« Elle est morte au milieu d’une nuit de délices…
Elle était le printemps, ouvrant de frais calices ;
Elle était l’Orient ;
Gaie, elle ressemblait à tout ce qu’on désire ;
L’esquif, entrant dès l’aube au golfe de Nisyre,
N’est pas plus souriant.
« Elle était la plus belle et la plus douce chose !
Son âme était le lys, son corps était la rose ;
Son chant chassait les pleurs ;
Nue, elle était Déesse, et Vierge, sous ses voiles ;
Elle avait le parfum que n’ont pas les étoiles,
L’éclair qui manque aux fleurs.
« Elle était la lumière et la grâce ; je l’aime !
Je la veux ! ô transports ! ô volupté suprême !
Ô regrets déchirants !… » —
Voilà huit jours qu’elle est dans mon ombre farouche ;
Si tu veux lui donner un baiser sur la bouche,
Prends-la, je te la rends !
Reprends ce corps, reprends ce sein, reprends ces lèvres ;
Cherches-y ton plaisir, ton extase, tes fièvres ;
Je la rends à tes vœux ;
Viens, tu peux, pour ta joie et tes jeux et tes fautes,
La reprendre, pourvu seulement que tu m’ôtes
De ses sombres cheveux.
Nous rions, l’ombre et moi, de tout ce qui vous navre.
Nous avons, nous aussi, notre fleur, le cadavre ;
La femme au front charmant,
Blanche, embaumant l’alcôve et parfumant la table,
Se transforme en ma nuit… — Viens voir quel formidable
Épanouissement !
Cette rose du fond du tombeau, viens la prendre,
Je te la rends. Reprends, jeune homme, dans ma cendre,
Dans mon fatal sillon,
Cette fleur où ma bave épouvantable brille,
Et qui, pâle, a le ver du cercueil pour chenille,
L’âme pour papillon.
Elle est morte, — et c’est là ta poignante pensée, —
Au moment le plus doux d’une nuit insensée ;
Eh bien, tu n’es plus seul,
Reprends-la ; ce lit froid vaut bien ton lit frivole ;
Entre ; et toi qui riais de la chemise folle,
Viens braver le linceul.
Elle t’attend, levant son crâne où l’œil se creuse ;
T’offrant sa main verdie et sa hanche terreuse,
Son flanc, mon noir séjour…
Viens, couvrant de baisers son vague rire horrible,
Dans ce commencement d’éternité terrible
Finir ta nuit d’amour !
*
Ô vie universelle, où donc est ton dictame ?
Qu’est-ce que ton baiser ? Un lèchement de flamme.
Le cœur humain veut tout,
Prend tout, l’or, le plaisir, le ciel bleu, l’herbe verte…
Et dans l’éternité sinistrement ouverte
Se vide tout à coup.
La vie est une joie où le meurtre fourmille,
Et la création se dévore en famille.
Baal dévore Pan.
L’arbre, s’il le pouvait, épuiserait la sève,
Léviathan, bâillant dans les ténèbres, rêve
D’engloutir l’Océan ;
L’onagre est au boa qui glisse et l’enveloppe ;
Le lynx tacheté saute et saisit l’antilope ;
La rouille use le fer ;
La mort du grand lion est la fête des mouches ;
On voit sous l’eau s’ouvrir confusément les bouches
Des bêtes de la mer ;
Le crocodile affreux, dont le Nil cache l’antre,
Et qui laisse aux roseaux la marque de son ventre,
À peur de l’ichneumon ;
L’hirondelle devant le gypaète émigre ;
Le colibri, sitôt qu’il a faim, devient tigre ;
L’oiseau-mouche est démon.
Le volcan, c’est le feu chez lui, tyran et maître,
Mâchant les durs rochers, féroce et parfois traître,
Tel qu’un sombre empereur,
Essuyant la fumée à sa bouche rougie,
Et son cratère enflé de lave est une orgie
De flammes en fureur ;
La louve est sur l’agneau comme l’agneau sur l’herbe ;
Le pâle genre humain n’est qu’une grande gerbe
De peuples pour les rois ;
Avril donne aux fleurs l’ambre et la rosée aux plantes
Pour l’assouvissement des abeilles volantes
Dans la lueur des bois ;
De toutes parts on broute, on veut vivre, on dévore,
L’ours dans la neige horrible et l’oiseau dans l’aurore ;
C’est l’ivresse et la loi.
Le monde est un festin. Je mange les convives.
L’océan a des bords, ma faim n’a pas de rives ;
Et le gouffre, c’est moi.
Vautour, qu’apportes-tu ? — Les morts de la mêlée,
Les morts des camps, les morts de la ville brûlée,
Et le chef rayonnant. —
C’est bien, donne le sang, vautour ; donne la cendre,
Donne les légions, c’est bien ; donne Alexandre,
C’est bien. Toi maintenant !
Le miracle hideux, le prodige sublime,
C’est que l’atome soit en même temps l’abîme ;
Tout d’en haut m’est jeté ;
Je suis d’autant plus grand que je suis plus immonde ;
Et l’amoindrissement formidable du monde
Fait mon énormité.
*
Fouillez la mort. Fouillez l’écroulement terrible.
Que trouvez-vous ? L’insecte. Et, quoique ayant la bible,
Quoique ayant le koran,
Je ne suis rien qu’un ver. Ô vivants, c’est peut-être
Parce que je suis fait des croyances du prêtre,
Des splendeurs du tyran,
C’est parce qu’en ma nuit j’ai mangé vos victoires,
C’est parce que je suis composé de vos gloires
Dont l’éclat retentit,
De toutes vos fiertés, de toutes vos durées,
De toutes vos grandeurs, tour à tour dévorées,
Que je reste petit.
Qu’est-ce que l’univers ? Qu’est-ce que le mystère ?
Une table sans fin servie au ver de terre ;
Le nain partout béant ;
Un engloutissement du géant par l’atome ;
Tout lentement rongé par Rien ; et le fantôme
Créé par le néant.
*
L’épouvante m’adore, et, ver, j’ai des pontifes.
Mon spectre prend une aile et mon aile a des griffes.
Vil, infect, chassieux,
Chétif, je me dilate en une immense forme,
Je plane, et par moments, chauve-souris énorme,
J’enveloppe les cieux.
*
Dieu qui m’avez fait ver, je vous ferai fumée.
Si je ne puis toucher votre essence innommée,
Je puis ronger du moins
L’amour dans l’homme, et l’astre au fond du ciel livide,
Dieu jaloux, et, faisant autour de vous le vide,
Vous ôter vos témoins.
Parce que l’astre luit, l’homme aurait tort de croire
Que le ver du tombeau n’atteint pas cette gloire ;
Hors moi, rien n’est réel ;
Le ver est sous l’azur comme il est sous le marbre ;
Je mords, en même temps que la pomme sur l’arbre,
L’étoile dans le ciel.
L’astre à ronger là-haut n’est pas plus difficile
Que la grappe pendante aux pampres de Sicile ;
J’abrège les rayons ;
L’éternité n’est point aux splendeurs complaisante ;
La mouche, la fourmi, tout meurt, et rien n’exempte
Les constellations.
Il faut, dans l’océan d’en haut, que le navire
Fait d’étoiles s’entr’ouvre à la fin et chavire ;
Saturne au large anneau
Chancelle, et Sirius subit ma sombre attaque,
Comme l’humble bateau qui va du port d’Ithaque
Au port de Calymno.
Il est dans le ciel noir des mondes plus malades
Que la barque au radoub sur un quai des Cyclades ;
L’abîme est un tyran ;
Arcturus dans l’éther cherche en vain une digue ;
La navigation de l’infini fatigue
Le vaste Aldebaran.
Les lunes sont, au fond de l’azur, des cadavres ;
On voit des globes morts dans les célestes havres
Là-haut se dérober ;
La comète est un monde éventré dans les ombres
Qui se traîne, laissant de ses entrailles sombres
La lumière tomber.
Regardez l’abbadir et voyez le bolide ;
L’un tombe, et l’autre meurt ; le ciel n’est pas solide ;
L’ombre a d’affreux recoins ;
Le point du jour blanchit les fentes de l’espace,
Et semble la lueur d’une lampe qui passe
Entre des ais mal joints.
Le monde, avec ses feux, ses chants, ses harmonies,
N’est qu’une éclosion immense d’agonies
Sous le bleu firmament,
Un pêle-mêle obscur de souffles et de râles,
Et de choses de nuit, vaguement sépulcrales,
Qui flottent un moment.
Dieu subit ma présence ; il en est incurable.
Toute forme créée, ô nuit, est peu durable.
Ô nuit, tout est pour nous ;
Tout m’appartient, tout vient à moi, gloire guerrière,
Force, puissance et joie, et même la prière,
Puisque j’ai ses genoux.
La démolition, voilà mon diamètre.
Le zodiaque ardent, que Rhamsès a beau mettre
Sur son sanglant écu,
Craint le ver du sépulcre, et l’aube est ma sujette ;
L’escarboucle est ma proie, et le soleil me jette
Des regards de vaincu.
L’univers magnifique et lugubre a deux cimes.
Ô vivants, à ses deux extrémités sublimes,
Qui sont aurore et nuit,
La création triste, aux entrailles profondes,
Porte deux Tout-puissants, le Dieu qui fait les mondes,
Le ver qui les détruit.
Remarque
Ce long poème, comme vous avez pu le remarquer si vous avez écouté (et lu) jusqu’au bout, comprend quelques erreurs de diction. Je les ai laissées parce que c’est le jeu du vivant tout au long de cette année (entre le 17 août 2014 et ce 17 août 2015). J’ai enregistré chaque poème dans son intégralité et j’ai mis en ligne le résultat.
J’aime en particulier ce poème car j’en ai compris le sens après la lecture de Ça de Stephen King.