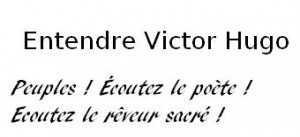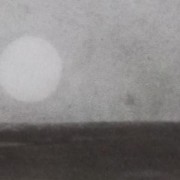XVI. Applaudissement
Applaudissement – Les références
Châtiments – Livre VI – La Stabilité est assurée ;
Collection Bouquins, Robert Laffont, Œuvres complètes de Victor Hugo, Poésie II, p 166.
Dans l’édition complète de 1870, il est placé en position XVII.
Applaudissement – Enregistrement
Je vous invite à écouter le poème Applaudissement, du Livre VI – La Stabilité est assurée, du recueil Châtiments, de Victor Hugo.
Applaudissement
Applaudissement – Le texte
XVI
Applaudissement
Ô grande nation, vous avez à cette heure,
Tandis qu’en bas dans l’ombre on souffre, on râle, on pleure,
Un empire qui fait sonner ses étriers,
Les éblouissements des panaches guerriers,
Une cour où pourrait trôner le roi de Thune,
Une Bourse où l’on peut faire en huit jours fortune,
Des rosières jetant aux soldats leurs bouquets ;
Vous avez des abbés, des juges, des laquais,
Dansant sur des sacs d’or une danse macabre,
La banque à deux genoux qui harangue le sabre,
Des boulets qu’on empile au fond des arsenaux,
Un sénat, les sermons remplaçant les journaux,
Des maréchaux dorés sur toutes les coutures,
Un Paris qu’on refait tout à neuf, des voitures
À huit chevaux, entrant dans le Louvre à grand bruit,
Des fêtes tout le jour, des bals toute la nuit,
Des lampions, des jeux, des spectacles ; en somme,
Tu t’es prostituée à ce misérable homme !
Tout ce que tu conquis est tombé de tes mains ;
On dit les vieux français comme les vieux romains,
Et leur nom fait songer leurs fils rouges de honte ;
Le monde aimait ta gloire et t’en demande compte,
Car il se réveillait au bruit de ton clairon.
Tu contemples d’un œil abruti ton Néron
Qu’entourent des Romieux déguisés en Sénèques ;
Tu te complais à voir brailler ce tas d’évêques
Qui, pendant que César se vautre en son harem,
Entonnent leur Salvum fac imperatorem.
(Au fait, faquin devait se trouver dans la phrase.)
Ton âme est comme un chien sous le pied qui l’écrase ;
Ton fier quatrevingt-neuf reçoit des coups de fouet
D’un gueux qu’hier encor l’Europe bafouait ;
Tes propres souvenirs, folle, tu les lapides.
La Marseillaise est morte à tes lèvres stupides.
Ton Champ de Mars subit ces vainqueurs répugnants,
Ces Maupas, ces Fortouls, ces Bertrands, ces Magnans,
Tous ces tueurs portant le tricorne en équerre,
Et Korte, et Carrelet, et Canrobert Macaire.
Tu n’es plus rien ; c’est dit, c’est fait, c’est établi.
Tu ne sais même plus, dans ce lugubre oubli,
Quelle est la nation qui brisa la Bastille.
On te voit le dimanche aller à la Courtille,
Riant, sautant, buvant, sans un instinct moral,
Comme une drôlesse ivre au bras d’un caporal.
Des soufflets qu’il te donne on ne sait plus le nombre.
Et, tout en revenant sur ce boulevard sombre
Où le meurtre a rempli tant de noirs corbillards,
Où bourgeois et passants, femmes, enfants, vieillards,
Tombèrent effarés d’une attaque soudaine,
Tu chantes Turlurette et la Faridondaine !
C’est bien, descends encore et je m’en réjouis,
Car ceci nous promet des retours inouïs,
Car, France, c’est ta loi de ressaisir l’espace,
Car tu seras bien grande ayant été si basse !
L’avenir a besoin d’un gigantesque effort.
Va, traîne l’affreux char d’un satrape ivre-mort,
Toi, qui de la victoire as conduit les quadriges.
J’applaudis. Te voilà condamnée aux prodiges.
Le monde, au jour marqué, te verra brusquement
Égaler la revanche à l’avilissement,
Ô Patrie, et sortir, changeant soudain de forme,
Par un immense éclat de cet opprobre énorme !
Oui, nous verrons, ainsi va le progrès humain,
De ce vil aujourd’hui naître un fier lendemain,
Et tu rachèteras, ô prêtresse, ô guerrière,
Par cent pas en avant chaque pas en arrière !
Donc recule et descends ! tombe, ceci me plaît !
Flatte le pied du maître et le pied du valet !
Plus bas ! baise Troplong ! plus bas ! lèche Baroche !
Descends, car le jour vient, descends, car l’heure approche,
Car tu vas t’élancer, ô grand peuple courbé,
Et, comme le jaguar dans un piège tombé,
Tu donnes pour mesure, en tes ardentes luttes,
À la hauteur des bonds la profondeur des chutes !
Oui, je me réjouis ; oui, j’ai la foi ; je sais
Qu’il faudra bien qu’enfin tu dises : c’est assez !
Tout passe à travers toi comme à travers le crible
Mais tu t’éveilleras bientôt, pâle et terrible,
Peuple, et tu deviendras superbe tout à coup.
De cet empire abject, bourbier, cloaque, égout,
Tu sortiras splendide, et ton aile profonde,
En secouant la fange, éblouira le monde !
Et les couronnes d’or fondront au front des rois,
Et le pape, arrachant sa tiare et sa croix,
Tremblant, se cachera comme un loup sous sa chaire,
Et la Thémis aux bras sanglants, cette bouchère,
S’enfuira vers la nuit, vieux monstre épouvanté,
Et tous les yeux humains s’empliront de clarté,
Et l’on battra des mains de l’un à l’autre pôle,
Et tous les opprimés, redressant leur épaule,
Se sentiront vainqueurs, délivrés et vivants,
Rien qu’à te voir jeter ta honte aux quatre vents !
Jersey, septembre 1853.