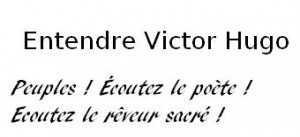XXVI. Ce que dit la bouche d’ombre
Ce que dit la bouche d’ombre – Les références
Les contemplations – Livre sixième : Au bord de l’infini ;
Collection Bouquins, Robert Laffont, Œuvres complètes de Victor Hugo – Poésie II, p 534.
Les mages – L’enregistrement
Je vous invite à écouter Ce que dit la bouche d’ombre, dernier poème du Livre sixième – Au bord de l’infini, des Contemplations, de Victor Hugo.
Il est précédé de XXV. Nomen, numen, lumen. Il est suivi du poème qui clôt Les Contemplations, adressé À celle qui est restée en France, sa fille, Léopoldine.
Ce que dit la bouche d’ombre
Ce que dit la bouche d’ombre – Le texte
XXVI
Ce que dit la bouche d’ombre
L’homme en songeant descend au gouffre universel.
J’errais près du dolmen qui domine Rozel,
À l’endroit où le cap se prolonge en presqu’île.
Le spectre m’attendait ; l’être sombre et tranquille
Me prit par les cheveux dans sa main qui grandit,
M’emporta sur le haut du rocher, et me dit :
*
Sache que tout connaît sa loi, son but, sa route ;
Que, de l’astre au ciron, l’immensité s’écoute ;
Que tout a conscience en la création ;
Et l’oreille pourrait avoir sa vision,
Car les choses et l’être ont un grand dialogue.
Tout parle, l’air qui passe et l’alcyon qui vogue,
Le brin d’herbe, la fleur, le germe, l’élément.
T’imaginais-tu donc l’univers autrement ?
Crois-tu que Dieu, par qui la forme sort du nombre,
Aurait fait à jamais sonner la forêt sombre,
L’orage, le torrent roulant de noirs limons,
Le rocher dans les flots, la bête dans les monts,
La mouche, le buisson, la ronce où croît la mûre,
Et qu’il n’aurait rien mis dans l’éternel murmure ?
Crois-tu que l’eau du fleuve et les arbres des bois,
S’ils n’avaient rien à dire, élèveraient la voix ?
Prends-tu le vent des mers pour un joueur de flûte ?
Crois-tu que l’océan, qui se gonfle et qui lutte,
Serait content d’ouvrir sa gueule jour et nuit
Pour souffler dans le vide une vapeur de bruit,
Et qu’il voudrait rugir, sous l’ouragan qui vole,
Si son rugissement n’était une parole ?
Crois-tu que le tombeau, d’herbe et de nuit vêtu,
Ne soit rien qu’un silence ? et te figures-tu
Que la création profonde, qui compose
Sa rumeur des frissons du lys et de la rose,
De la foudre, des flots, des souffles du ciel bleu,
Ne sait ce qu’elle dit quand elle parle à Dieu ?
Crois-tu qu’elle ne soit qu’une langue épaissie ?
Crois-tu que la nature énorme balbutie,
Et que Dieu se serait, dans son immensité,
Donné pour tout plaisir, pendant l’éternité,
D’entendre bégayer une sourde-muette ?
Non, l’abîme est un prêtre et l’ombre est un poëte ;
Non, tout est une voix et tout est un parfum ;
Tout dit dans l’infini quelque chose à quelqu’un ;
Une pensée emplit le tumulte superbe.
Dieu n’a pas fait un bruit sans y mêler le verbe.
Tout, comme toi, gémit ou chante comme moi ;
Tout parle. Et maintenant, homme, sais-tu pourquoi
Tout parle ? Écoute bien. C’est que vents, ondes, flammes
Arbres, roseaux, rochers, tout vit !
Tout est plein d’âmes.
Mais comment ? Oh ! voilà le mystère inouï.
Puisque tu ne t’es pas en route évanoui,
Causons.
*
Dieu n’a créé que l’être impondérable.
Il le fit radieux, beau, candide, adorable,
Mais imparfait ; sans quoi, sur la même hauteur,
La créature étant égale au créateur,
Cette perfection, dans l’infini perdue,
Se serait avec Dieu mêlée et confondue,
Et la création, à force de clarté,
En lui serait rentrée et n’aurait pas été.
La création sainte où rêve le prophète,
Pour être, ô profondeur ! devait être imparfaite.
Donc, Dieu fit l’univers, l’univers fit le mal.
L’être créé, paré du rayon baptismal,
En des temps dont nous seuls conservons la mémoire,
Planait dans la splendeur sur des ailes de gloire ;
Tout était chant, encens, flamme, éblouissement ;
L’être errait, aile d’or, dans un rayon charmant,
Et de tous les parfums tour à tour était l’hôte ;
Tout nageait, tout volait.
Or, la première faute
Fut le premier poids.
Dieu sentit une douleur.
Le poids prit une forme, et, comme l’oiseleur
Fuit emportant l’oiseau qui frissonne et qui lutte,
Il tomba, traînant l’ange éperdu dans sa chute.
Le mal était fait. Puis, tout alla s’aggravant ;
Et l’éther devint l’air, et l’air devint le vent ;
L’ange devint l’esprit, et l’esprit devint l’homme.
L’âme tomba, des maux multipliant la somme,
Dans la brute, dans l’arbre, et même, au-dessous d’eux,
Dans le caillou pensif, cet aveugle hideux.
Être vils qu’à regret les anges énumèrent !
Et de tous ces amas des globes se formèrent,
Et derrière ces blocs naquit la sombre nuit.
Le mal, c’est la matière. Arbre noir, fatal fruit.
*
Ne réfléchis-tu pas lorsque tu vois ton ombre ?
Cette forme de toi, rampante, horrible, sombre,
Qui, liée à tes pas comme un spectre vivant,
Va tantôt en arrière et tantôt en avant,
Qui se mêle à la nuit, sa grande sœur funeste,
Et qui contre le jour, noire et dure, proteste,
D’où vient-elle ? De toi, de ta chair, du limon
Dont l’esprit se revêt en devenant démon ;
De ce corps qui, créé par ta faute première,
Ayant rejeté Dieu, résiste à la lumière ;
De ta matière, hélas ! de ton iniquité.
Cette ombre dit : — Je suis l’être d’infirmité ;
Je suis tombé déjà ; je puis tomber encore. —
L’ange laisse passer à travers lui l’aurore ;
Nul simulacre obscur ne suit l’être aromal ;
Homme, tout ce qui fait de l’ombre a fait le mal.
*
Maintenant, c’est ici le rocher fatidique,
Et je vais t’expliquer tout ce que je t’indique ;
Je vais t’emplir les yeux de nuit et de lueurs.
Prépare-toi, front triste, aux funèbres sueurs.
Le vent d’en haut sur moi passe, et, ce qu’il m’arrache,
Je te le jette ; prends, et vois.
Et, d’abord, sache
Que le monde où tu vis est un monde effrayant
Devant qui le songeur, sous l’infini ployant,
Lève les bras au ciel et recule terrible.
Ton soleil est lugubre et ta terre est horrible.
Vous habitez le seuil du monde châtiment.
Mais vous n’êtes pas hors de Dieu complétement ;
Dieu, soleil dans l’azur, dans la cendre étincelle,
N’est hors de rien, étant la fin universelle ;
L’éclair est son regard, autant que le rayon ;
Et tout, même le mal, est la création,
Car le dedans du masque est encor la figure.
— Ô sombre aile invisible à l’immense envergure !
Esprit ! esprit ! esprit ! m’écriai-je éperdu.
Le spectre poursuivit sans m’avoir entendu :
*
Faisons un pas de plus dans ces choses profondes.
Homme, tu veux, tu fais, tu construis et tu fondes,
Et tu dis : — Je suis seul, car je suis le penseur.
L’univers n’a que moi dans sa morne épaisseur.
En deçà, c’est la nuit ; au-delà, c’est le rêve.
L’idéal est un œil que la science crève.
C’est moi qui suis la fin et qui suis le sommet. —
Voyons ; observes-tu le bœuf qui se soumet ?
Écoutes-tu le bruit de ton pas sur les marbres ?
Interroges-tu l’onde ? et, quand tu vois des arbres,
Parles-tu quelquefois à ces religieux ?
Comme sur le versant d’un mont prodigieux,
Vaste mêlée aux bruits confus, du fond de l’ombre,
Tu vois monter à toi la création sombre.
Le rocher est plus loin, l’animal est plus près.
Comme le faîte altier et vivant, tu parais !
Mais, dis, crois-tu que l’être illogique nous trompe ?
L’échelle que tu vois, crois-tu qu’elle se rompe ?
Crois-tu, toi dont les sens d’en haut sont éclairés,
Que la création qui, lente et par degrés,
S’élève à la lumière, et, dans sa marche entière,
Fait de plus de clarté luire moins de matière
Et mêle plus d’instincts au monstre décroissant,
Crois-tu que cette vie énorme, remplissant
De souffles le feuillage et de lueurs la tête,
Qui va du roc à l’arbre et de l’arbre à la bête,
Et de la pierre à toi monte insensiblement,
S’arrête sur l’abîme à l’homme, escarpement ?
Non, elle continue, invincible, admirable,
Entre dans l’invisible et dans l’impondérable,
Y disparaît pour toi, chair vile, emplit l’azur
D’un monde éblouissant, miroir du monde obscur,
D’êtres voisins de l’homme et d’autres qui s’éloignent,
D’esprits purs, de voyants dont les splendeurs témoignent,
D’anges faits de rayons comme l’homme d’instincts ;
Elle plonge à travers les cieux jamais atteints,
Sublime ascension d’échelles étoilées,
Des démons enchaînés monte aux âmes ailées,
Fait toucher le front sombre au radieux orteil,
Rattache l’astre esprit à l’archange soleil,
Relie, en traversant des millions de lieues,
Les groupes constellés et les légions bleues,
Peuple le haut, le bas, les bords et le milieu,
Et dans les profondeurs s’évanouit en Dieu !
Cette échelle apparaît vaguement dans la vie
Et dans la mort. Toujours les justes l’ont gravie :
Jacob en la voyant, et Caton sans la voir.
Ses échelons sont deuil, sagesse, exil, devoir.
Et cette échelle vient de plus loin que la terre.
Sache qu’elle commence aux mondes du mystère,
Aux mondes des terreurs et des perditions ;
Et qu’elle vient, parmi les pâles visions,
Du précipice où sont les larves et les crimes,
Où la création, effrayant les abîmes,
Se prolonge dans l’ombre en spectre indéfini.
Car, au-dessous du globe où vit l’homme banni,
Hommes, plus bas que vous, dans le nadir livide,
Dans cette plénitude horrible qu’on croit vide,
Le mal, qui par la chair, hélas ! vous asservit,
Dégorge une vapeur monstrueuse qui vit !
Là, sombre et s’engloutit, dans des flots de désastres,
L’hydre Univers tordant son corps écaillé d’astres ;
Là, tout flotte et s’en va dans un naufrage obscur ;
Dans ce gouffre sans bord, sans soupirail, sans mur,
De tout ce qui vécut pleut sans cesse la cendre ;
Et l’on voit tout au fond, quand l’œil ose y descendre,
Au delà de la vie, et du souffle et du bruit,
Un affreux soleil noir d’où rayonne la nuit !
*
Donc, la matière pend à l’idéal, et tire
L’esprit vers l’animal, l’ange vers le satyre,
Le sommet vers le bas, l’amour vers l’appétit.
Avec le grand qui croule elle fait le petit.
Comment de tant d’azur tant de terreur s’engendre,
Comment le jour fait l’ombre et le feu pur la cendre,
Comment la cécité peut naître du voyant,
Comment le ténébreux descend du flamboyant,
Comment du monstre esprit naît le monstre matière,
Un jour, dans le tombeau, sinistre vestiaire,
Tu le sauras ; la tombe est faite pour savoir ;
Tu verras ; aujourd’hui, tu ne peux qu’entrevoir ;
Mais, puisque Dieu permet que ma voix t’avertisse,
Je te parle.
Et, d’abord, qu’est-ce que la justice ?
Qui la rend ? qui la fait ? où ? quand ? à quel moment ?
Qui donc pèse la faute ? et qui le châtiment ?
*
L’être créé se meut dans la lumière immense.
Libre, il sait où le bien cesse, où le mal commence ;
Il a ses actions pour juges.
Il suffit
Qu’il soit méchant ou bon ; tout est dit. Ce qu’on fit,
Crime, est notre geôlier, ou, vertu, nous délivre.
L’être ouvre à son insu de lui-même le livre ;
Sa conscience calme y marque avec le doigt
Ce que l’ombre lui garde ou ce que Dieu lui doit.
On agit, et l’on gagne ou l’on perd à mesure ;
On peut être étincelle ou bien éclaboussure ;
Lumière ou fange, archange au vol d’aigle ou bandit ;
L’échelle vaste est là. Comme je te l’ai dit,
Par des zones sans fin la vie universelle
Monte, et par des degrés innombrables ruisselle,
Depuis l’infâme nuit jusqu’au charmant azur.
L’être en la traversant devient mauvais ou pur.
En haut plane la joie ; en bas l’horreur se traîne.
Selon que l’âme, aimante, humble, bonne, sereine,
Aspire à la lumière et tend vers l’idéal,
Ou s’alourdit, immonde, au poids croissant du mal,
Dans la vie infinie on monte et l’on s’élance,
Ou l’on tombe ; et tout être est sa propre balance.
Dieu ne nous juge point. Vivant tous à la fois,
Nous pesons, et chacun descend selon son poids.
*
Hommes ! nous n’approchons que les paupières closes
De ces immensités d’en bas.
Viens, si tu l’oses !
Regarde dans ce puits morne et vertigineux,
De la création compte les sombres nœuds,
Viens, vois, sonde :
Au-dessous de l’homme qui contemple,
Qui peut être un cloaque ou qui peut être un temple,
Être en qui l’instinct vit dans la raison dissous,
Est l’animal courbé vers la terre ; au-dessous
De la brute est la plante inerte, sans paupière
Et sans cris ; au-dessous de la plante est la pierre ;
Au-dessous de la pierre est le chaos sans nom.
Avançons dans cette ombre et sois mon compagnon.
*
Toute faute qu’on fait est un cachot qu’on s’ouvre.
Les mauvais, ignorant quel mystère les couvre,
Les êtres de fureur, de sang, de trahison,
Avec leurs actions bâtissent leur prison ;
Tout bandit, quand la mort vient lui toucher l’épaule
Et l’éveille, hagard, se retrouve en la geôle
Que lui fit son forfait derrière lui rampant ;
Tibère en un rocher, Séjan dans un serpent.
L’homme marche sans voir ce qu’il fait dans l’abîme.
L’assassin pâlirait s’il voyait sa victime ;
C’est lui. L’oppresseur vil, le tyran sombre et fou,
En frappant sans pitié sur tous, forge le clou
Qui le clouera dans l’ombre au fond de la matière.
Les tombeaux sont les trous du crible cimetière,
D’où tombe, graine obscure en un ténébreux champ,
L’effrayant tourbillon des âmes.
*
Tout méchant
Fait naître en expirant le monstre de sa vie,
Qui le saisit. L’horreur par l’horreur est suivie.
Nemrod gronde enfermé dans la montagne à pic ;
Quand Dalila descend dans la tombe, un aspic
Sort des plis du linceul, emportant l’âme fausse ;
Phryné meurt, un crapaud saute hors de la fosse ;
Ce scorpion au fond d’une pierre dormant,
C’est Clytemnestre aux bras d’Égisthe son amant ;
Du tombeau d’Anitus il sort une ciguë ;
Le houx sombre et l’ortie à la piqûre aiguë
Pleurent quand l’aquilon les fouette, et l’aquilon
Leur dit : Tais-toi, Zoïle ! et souffre, Ganelon !
Dieu livre, choc affreux dont la plaine au loin gronde,
Au cheval Brunehaut le pavé Frédégonde ;
La pince qui rougit dans le brasier hideux
Est faite du duc d’Albe et de Philippe deux ;
Farinace est le croc des noires boucheries ;
L’orfraie au fond de l’ombre a les yeux de Jeffryes ;
Tristan est au secret dans le bois d’un gibet.
Quand tombent dans la mort tous ces brigands, Macbeth,
Ezzelin, Richard trois, Carrier, Ludovic Sforce,
La matière leur met la chemise de force.
Oh ! comme en son bonheur, qui masque un sombre arrêt,
Messaline ou l’horrible Isabeau frémirait,
Si, dans ses actions du sépulcre voisines,
Cette femme sentait qu’il lui vient des racines,
Et qu’ayant été monstre, elle deviendra fleur !
À chacun son forfait ! à chacun sa douleur !
Claude est l’algue que l’eau traîne de havre en havre ;
Xercès est excrément, Charles neuf est cadavre ;
Hérode, c’est l’osier des berceaux vagissants ;
L’âme du noir Judas, depuis dix-huit cents ans,
Se disperse et renaît dans les crachats des hommes ;
Et le vent qui jadis soufflait sur les Sodomes
Mêle, dans l’âtre abject et sous le vil chaudron,
La fumée Érostrate à la flamme Néron.
*
Et tout, bête, arbre et roche, étant vivant sur terre,
Tout est monstre, excepté l’homme, esprit solitaire.
L’âme que sa noirceur chasse du firmament
Descend dans les degrés divers du châtiment
Selon que plus ou moins d’obscurité la gagne.
L’homme en est la prison, la bête en est le bagne,
L’arbre en est le cachot, la pierre en est l’enfer.
Le ciel d’en haut, le seul qui soit splendide et clair,
La suit des yeux dans l’ombre, et, lui jetant l’aurore,
Tâche, en la regardant, de l’attirer encore.
Ô chute ! dans la bête, à travers les barreaux
De l’instinct obstruant de pâles soupiraux,
Ayant encor la voix, l’essor et la prunelle,
L’âme entrevoit de loin la lueur éternelle ;
Dans l’arbre elle frissonne, et, sans jour et sans yeux,
Sent encor dans le vent quelque chose des cieux ;
Dans la pierre elle rampe, immobile, muette,
Ne voyant même plus l’obscure silhouette
Du monde qui s’éclipse et qui s’évanouit,
Et face à face avec son crime dans la nuit.
L’âme en ces trois cachots traîne sa faute noire.
Comme elle en a la forme, elle en a la mémoire ;
Elle sait ce qu’elle est ; et, tombant sans appuis,
Voit la clarté décroître à la paroi du puits ;
Elle assiste à sa chute, et, dur caillou qui roule,
Pense : Je suis Octave ; et, vil chardon qu’on foule,
Crie au talon : Je suis Attila le géant ;
Et, ver de terre au fond du charnier, et rongeant
Un crâne infect et noir, dit : Je suis Cléopâtre.
Et, hibou, malgré l’aube, ours, en bravant le pâtre,
Elle accomplit la loi qui l’enchaîne d’en haut ;
Pierre, elle écrase ; épine, elle pique ; il le faut.
Le monstre est enfermé dans son horreur vivante.
Il aurait beau vouloir dépouiller l’épouvante ;
Il faut qu’il reste horrible et reste châtié ;
Ô mystère ! le tigre a peut-être pitié !
Le tigre sur son dos, qui peut-être eut une aile,
A l’ombre des barreaux de la cage éternelle ;
Un invisible fil lie aux noirs échafauds
Le noir corbeau dont l’aile est en forme de faulx ;
L’âme louve ne peut s’empêcher d’être louve,
Car le monstre est tenu, sous le ciel qui l’éprouve,
Dans l’expiation par la fatalité.
Jadis, sans la comprendre et d’un œil hébété,
L’Inde a presque entrevu cette métempsycose.
La ronce devient griffe, et la feuille de rose
Devient langue de chat, et, dans l’ombre et les cris,
Horrible, lèche et boit le sang de la souris ;
Qui donc connaît le monstre appelé mandragore ?
Qui sait ce que, le soir, éclaire le fulgore,
Être en qui la laideur devient une clarté ?
Ce qui se passe en l’ombre où croît la fleur d’été
Efface la terreur des antiques avernes.
Étages effrayants ! cavernes sur cavernes.
Ruche obscure du mal, du crime et du remord !
Donc, une bête va, vient, rugit, hurle, mord ;
Un arbre est là, dressant ses branches hérissées,
Une dalle s’effondre au milieu des chaussées
Que la charrette écrase et que l’hiver détruit,
Et, sous ces épaisseurs de matière et de nuit,
Arbre, bête, pavé, poids que rien ne soulève,
Dans cette profondeur terrible, une âme rêve !
Que fait-elle ? Elle songe à Dieu !
*
Fatalité !
Échéance ! retour ! revers ! autre côté !
Ô loi ! pendant qu’assis à table, joyeux groupes,
Les pervers, les puissants, vidant toutes les coupes,
Oubliant qu’aujourd’hui par demain est guetté,
Étalent leur mâchoire en leur folle gaîté,
Voilà ce qu’en sa nuit muette et colossale,
Montrant comme eux ses dents tout au fond de la salle,
Leur réserve la mort, ce sinistre rieur !
Nous avons, nous, voyants du ciel supérieur,
Le spectacle inouï de vos régions basses.
Ô songeur, fallait-il qu’en ces nuits tu tombasses !
Nous écoutons le cri de l’immense malheur.
Au-dessus d’un rocher, d’un loup ou d’une fleur,
Parfois nous apparaît l’âme à mi-corps sortie,
Pauvre ombre en pleurs qui lutte, hélas ! presque engloutie ;
Le loup la tient, le roc étreint ses pieds qu’il tord,
Et la fleur implacable et féroce la mord.
Nous entendons le bruit du rayon que Dieu lance,
La voix de ce que l’homme appelle le silence,
Et vos soupirs profonds, cailloux désespérés !
Nous voyons la pâleur de tous les fronts murés.
À travers la matière, affreux caveau sans portes,
L’ange est pour nous visible avec ses ailes mortes.
Nous assistons aux deuils, au blasphème, aux regrets,
Aux fureurs ; et, la nuit, nous voyons les forêts,
D’où cherchent à s’enfuir les larves enfermées,
S’écheveler dans l’ombre en lugubres fumées.
Partout, partout, partout ! dans les flots, dans les bois,
Dans l’herbe en fleur, dans l’or qui sert de sceptre aux rois,
Dans le jonc dont Hermès se fait une baguette,
Partout, le châtiment contemple, observe ou guette,
Sourd aux questions, triste, affreux, pensif, hagard ;
Et tout est l’œil d’où sort ce terrible regard.
Ô châtiment ! dédale aux spirales funèbres !
Construction d’en bas qui cherche les ténèbres,
Plonge au-dessous du monde et descend dans la nuit,
Et, Babel renversée, au fond de l’ombre fuit !
L’homme qui plane et rampe, être crépusculaire,
En est le milieu.
*
L’homme est clémence et colère ;
Fond vil du puits, plateau radieux de la tour ;
Degré d’en haut pour l’ombre, et d’en bas pour le jour.
L’ange y descend, la bête après la mort y monte ;
Pour la bête, il est gloire, et, pour l’ange, il est honte ;
Dieu mêle en votre race, hommes infortunés,
Les demi-dieux punis aux monstres pardonnés.
De là vient que parfois, mystère que Dieu mène ! –
On entend d’une bouche en apparence humaine
Sortir des mots pareils à des rugissements,
Et que, dans d’autres lieux et dans d’autres moments,
On croit voir sur un front s’ouvrir des ailes d’anges.
Roi forçat, l’homme, esprit, pense, et, matière, mange.
L’âme en lui ne se peut dresser sur son séant.
L’homme, comme la brute abreuvé de néant,
Vide toutes les nuits le verre noir du somme.
La chaîne de l’enfer, liée au pied de l’homme,
Ramène chaque jour vers le cloaque impur
La beauté, le génie, envolés dans l’azur,
Mêle la peste au souffle idéal des poitrines,
Et traîne, avec Socrate, Aspasie aux latrines.
*
Par un côté pourtant l’homme est illimité.
Le monstre a le carcan, l’homme a la liberté.
Songeur, retiens ceci : l’homme est un équilibre.
L’homme est une prison où l’âme reste libre.
L’âme, dans l’homme, agit, fait le bien, fait le mal,
Remonte vers l’esprit, retombe à l’animal ;
Et pour que, dans son vol vers les cieux, rien ne lie
Sa conscience ailée et de Dieu seul remplie,
Dieu, quand une âme éclôt dans l’homme au bien poussé,
Casse en son souvenir le fil de son passé ;
De là vient que la nuit en sait plus que l’aurore.
Le monstre se connaît lorsque l’homme s’ignore.
Le monstre est la souffrance, et l’homme est l’action.
L’homme est l’unique point de la création
Où, pour demeurer libre en se faisant meilleure,
L’âme doive oublier sa vie antérieure.
Mystère ! au seuil de tout l’esprit rêve ébloui.
*
L’homme ne voit pas Dieu, mais peut aller à lui,
En suivant la clarté du bien, toujours présente ;
Le monstre, arbre, rocher ou bête rugissante,
Voit Dieu, c’est là sa peine, et reste enchaîné loin.
L’homme a l’amour pour aile, et pour joug le besoin.
L’ombre est sur ce qu’il voit par lui-même semée ;
La nuit sort de son œil ainsi qu’une fumée ;
Homme, tu ne sais rien ; tu marches, pâlissant !
Parfois le voile obscur qui te couvre, ô passant,
S’envole et flotte au vent soufflant d’une autre sphère,
Gonfle un moment ses plis jusque dans la lumière,
Puis retombe sur toi, spectre, et redevient noir.
Tes sages, tes penseurs ont essayé de voir ;
Qu’ont-ils vu ? qu’ont-ils fait ? qu’ont-ils dit, ces fils d’Ève ?
Rien.
Homme ! autour de toi la création rêve.
Mille êtres inconnus t’entourent dans ton mur.
Tu vas, tu viens, tu dors sous leur regard obscur,
Et tu ne les sens pas vivre autour de ta vie.
Toute une légion d’âmes t’est asservie ;
Pendant qu’elle te plaint, tu la foules aux pieds.
Tous tes pas vers le jour sont par l’ombre épiés.
Ce que tu nommes chose, objet, nature morte,
Sait, pense, écoute, entend. Le verrou de ta porte
Voit arriver ta faute et voudrait se fermer.
Ta vitre connaît l’aube, et dit : Voir ! croire ! aimer !
Les rideaux de ton lit frissonnent de tes songes.
Dans les mauvais desseins quand, rêveur, tu te plonges,
La cendre dit au fond de l’âtre sépulcral :
Regarde-moi ; je suis ce qui reste du mal.
Hélas ! l’homme imprudent trahit, torture, opprime.
La bête en son enfer voit les deux bouts du crime ;
Un loup pourrait donner des conseils à Néron.
Homme ! homme ! aigle aveuglé, moindre qu’un moucheron !
Pendant que dans ton Louvre ou bien dans ta chaumière
Tu vis, sans même avoir épelé la première
Des constellations, sombre alphabet qui luit
Et tremble sur la page immense de la nuit,
Pendant que tu maudis et pendant que tu nies,
Pendant que tu dis : Non ! aux astres ; aux génies :
Non ! à l’idéal : Non ! à la vertu : Pourquoi ?
Pendant que tu te tiens en dehors de la loi,
Copiant les dédains inquiets ou robustes
De ces sages qu’on voit rêver dans les vieux bustes,
Et que tu dis : Que sais-je ? amer, froid, mécréant,
Prostituant ta bouche au rire du néant,
À travers le taillis de la nature énorme,
Flairant l’éternité de son museau difforme,
Là, dans l’ombre, à tes pieds, homme, ton chien voit Dieu.
Ah ! je t’entends. Tu dis : — Quel deuil ! la bête est peu,
L’homme n’est rien. Ô loi misérable ! ombre ! abîme ! —
*
Ô songeur ! cette loi misérable est sublime.
Il faut donc tout redire à ton esprit chétif !
À la fatalité, loi du monstre captif,
Succède le devoir, fatalité de l’homme.
Ainsi de toutes parts l’épreuve se consomme,
Dans le monstre passif, dans l’homme intelligent,
La nécessité morne en devoir se changeant ;
Et l’âme, remontant à sa beauté première,
Va de l’ombre fatale à la libre lumière.
Or, je te le redis, pour se transfigurer,
Et pour se racheter, l’homme doit ignorer.
Il doit être aveuglé par toutes les poussières.
Sans quoi, comme l’enfant guidé par des lisières,
L’homme vivrait, marchant droit à la vision.
Douter est sa puissance et sa punition.
Il voit la rose, et nie ; il voit l’aurore, et doute ;
Où serait le mérite à retrouver sa route,
Si l’homme, voyant clair, roi de sa volonté,
Avait la certitude, ayant la liberté ?
Non. Il faut qu’il hésite en la vaste nature,
Qu’il traverse du choix l’effrayante aventure,
Et qu’il compare au vice agitant son miroir,
Au crime, aux voluptés, l’œil en pleurs du devoir ;
Il faut qu’il doute ! hier croyant, demain impie ;
Il court du mal au bien ; il scrute, sonde, épie,
Va, revient, et, tremblant, agenouillé, debout,
Les bras étendus, triste, il cherche Dieu partout ;
Il tâte l’infini jusqu’à ce qu’il l’y sente ;
Alors, son âme ailée éclate frémissante ;
L’ange éblouissant luit dans l’homme transparent,
Le doute le fait libre, et la liberté, grand.
La captivité sait ; la liberté suppose,
Creuse, saisit l’effet, le compare à la cause,
Croit vouloir le bien-être et veut le firmament ;
Et, cherchant le caillou, trouve le diamant.
C’est ainsi que du ciel l’âme à pas lents s’empare.
Dans le monstre, elle expie ; en l’homme, elle répare.
*
Oui, ton fauve univers est le forçat de Dieu.
Les constellations, sombres lettres de feu,
Sont les marques du bagne à l’épaule du monde.
Dans votre région tant d’épouvante abonde,
Que, pour l’homme, marqué lui-même du fer chaud,
Quand il lève les yeux vers les astres, là-haut,
Le cancer resplendit, le scorpion flamboie,
Et dans l’immensité le chien sinistre aboie !
Ces soleils inconnus se groupent sur son front
Comme l’effroi, le deuil, la menace et l’affront ;
De toutes parts s’étend l’ombre incommensurable ;
En bas l’obscur, l’impur, le mauvais, l’exécrable,
Le pire, tas hideux, fourmillent ; tout au fond,
Ils échangent entre eux dans l’ombre ce qu’ils font ;
Typhon donne l’horreur, Satan donne le crime ;
Lugubre intimité du mal et de l’abîme !
Amours de l’âme monstre et du monstre univers !
Baiser triste ! et l’informe engendré du pervers,
La matière, le bloc, la fange, la géhenne,
L’écume, le chaos, l’hiver, nés de la haine,
Les faces de beauté qu’habitent des démons,
Tous les êtres maudits, mêlés aux vils limons,
Pris par la plante fauve et la bête féroce,
Le grincement de dents, la peur, le rire atroce,
L’orgueil, que l’infini courbe sous son niveau,
Rampent, noirs prisonniers, dans la nuit, noir caveau.
La porte, affreuse et faite avec de l’ombre, est lourde ;
Par moments, on entend, dans la profondeur sourde,
Les efforts que les monts, les flots, les ouragans,
Les volcans, les forêts, les animaux brigands,
Et tous les monstres font pour soulever le pêne.
Et sur cet amas d’ombre, et de crime, et de peine,
Ce grand ciel formidable est le scellé de Dieu.
Voilà pourquoi, songeur dont la mort est le vœu,
Tant d’angoisse est empreinte au front des cénobites !
Je viens de te montrer le gouffre. Tu l’habites.
*
Les mondes, dans la nuit que vous nommez l’azur,
Par les brèches que fait la mort blême à leur mur,
Se jettent en fuyant l’un à l’autre des âmes.
Dans votre globe où sont tant de geôles infâmes,
Vous avez des méchants de tous les univers,
Condamnés qui, venus des cieux les plus divers,
Rêvent dans vos rochers ou dans vos arbres ploient ;
Tellement stupéfaits de ce monde qu’ils voient,
Qu’eussent-ils la parole, ils ne pourraient parler.
On en sent quelques-uns frissonner et trembler.
De là les songes vains du bonze et de l’augure.
Donc, représente-toi cette sombre figure :
Ce gouffre, c’est l’égout du mal universel.
Ici vient aboutir de tous les points du ciel
La chute des punis, ténébreuse traînée.
Dans cette profondeur, morne, âpre, infortunée,
De chaque globe il tombe un flot vertigineux
D’âmes, d’esprits malsains et d’êtres vénéneux,
Flot que l’éternité voit sans fin se répandre.
Chaque étoile au front d’or qui brille, laisse pendre
Sa chevelure d’ombre en ce puits effrayant.
Âme immortelle, vois, et frémis en voyant :
Voilà le précipice exécrable où tu sombres.
*
Oh ! qui que vous soyez, qui passez dans ces ombres,
Versez votre pitié sur ces douleurs sans fond !
Dans ce gouffre, où l’abîme en l’abîme se fond,
Se tordent les forfaits, transformés en supplices,
L’effroi, le deuil, le mal, les ténèbres complices,
Les pleurs sous la toison, le soupir expiré
Dans la fleur, et le cri dans la pierre muré !
Oh ! qui que vous soyez, pleurez sur ces misères !
Pour Dieu seul, qui sait tout, elles sont nécessaires ;
Mais vous pouvez pleurer sur l’énorme cachot
Sans déranger le sombre équilibre d’en haut !
Hélas ! hélas ! hélas ! tout est vivant ! tout pense !
La mémoire est la peine, étant la récompense.
Oh ! comme ici l’on souffre et comme on se souvient !
Torture de l’esprit que la matière tient !
La brute et le granit, quel chevalet pour l’âme !
Ce mulet fut sultan, ce cloporte était femme.
L’arbre est un exilé, la roche est un proscrit.
Est-ce que, quelque part, par hasard, quelqu’un rit
Quand ces réalités sont là, remplissant l’ombre ?
La ruine, la mort, l’ossement, le décombre,
Sont vivants. Un remords songe dans un débris.
Pour l’œil profond qui voit, les antres sont des cris.
Hélas ! le cygne est noir, le lys songe à ses crimes ;
La perle est nuit ; la neige est la fange des cimes ;
Le même gouffre, horrible et fauve, et sans abri,
S’ouvre dans la chouette et dans le colibri ;
La mouche, âme, s’envole et se brûle à la flamme ;
Et la flamme, esprit, brûle avec angoisse une âme ;
L’horreur fait frissonner les plumes de l’oiseau ;
Tout est douleur.
Les fleurs souffrent sous le ciseau,
Et se ferment ainsi que des paupières closes ;
Toutes les femmes sont teintes du sang des roses ;
La vierge au bal, qui danse, ange aux fraîches couleurs,
Et qui porte en sa main une touffe de fleurs,
Respire en soupirant un bouquet d’agonies.
Pleurez sur les laideurs et les ignominies,
Pleurez sur l’araignée immonde, sur le ver,
Sur la limace au dos mouillé comme l’hiver,
Sur le vil puceron qu’on voit aux feuilles pendre,
Sur le crabe hideux, sur l’affreux scolopendre,
Sur l’effrayant crapaud, pauvre monstre aux doux yeux,
Qui regarde toujours le ciel mystérieux !
Plaignez l’oiseau de crime et la bête de proie.
Ce que Domitien, césar, fit avec joie,
Tigre, il le continue avec horreur. Verrès,
Qui fut loup sous la pourpre, est loup dans les forêts ;
Il descend, réveillé, l’autre côté du rêve ;
Son rire, au fond des bois, en hurlement s’achève ;
Pleurez sur ce qui hurle et pleurez sur Verrès.
Sur ces tombeaux vivants, masqués d’obscurs arrêts,
Penchez-vous attendri ! versez votre prière !
La pitié fait sortir des rayons de la pierre.
Plaignez le louveteau, plaignez le lionceau.
La matière, affreux bloc, n’est que le lourd monceau
Des effets monstrueux, sortis des sombres causes.
Ayez pitié. Voyez des âmes dans les choses.
Hélas ! le cabanon subit aussi l’écrou ;
Plaignez le prisonnier, mais plaignez le verrou ;
Plaignez la chaîne au fond des bagnes insalubres ;
La hache et le billot sont deux êtres lugubres ;
La hache souffre autant que le corps, le billot
Souffre autant que la tête ; ô mystères d’en haut !
Ils se livrent une âpre et hideuse bataille ;
Il ébrèche la hache, et la hache l’entaille ;
Ils se disent tout bas l’un à l’autre : Assassin !
Et la hache maudit les hommes, sombre essaim,
Quand, le soir, sur le dos du bourreau, son ministre,
Elle revient dans l’ombre, et luit, miroir sinistre,
Ruisselante de sang et reflétant les cieux ;
Et, la nuit, dans l’étal morne et silencieux,
Le cadavre au cou rouge, effrayant, glacé, blême,
Seul, sait ce que lui dit le billot, tronc lui-même.
Oh ! que la terre est froide et que les rocs sont durs !
Quelle muette horreur dans les halliers obscurs !
Les pleurs noirs de la nuit sur la colombe blanche
Tombent ; le vent met nue et torture la branche ;
Quel monologue affreux dans l’arbre aux rameaux verts !
Quel frisson dans l’herbe ! Oh ! quels yeux fixes ouverts
Dans les cailloux profonds, oubliettes des âmes !
C’est une âme que l’eau scie en ses froides lames ;
C’est une âme que fait ruisseler le pressoir.
Ténèbres ! l’univers est hagard. Chaque soir,
Le noir horizon monte et la nuit noire tombe ;
Tous deux, à l’occident, d’un mouvement de tombe,
Ils vont se rapprochant, et, dans le firmament,
Ô terreur ! sur le joug, écrasé lentement,
La tenaille de l’ombre effroyable se ferme.
Oh ! les berceaux font peur. Un bagne est dans un germe.
Ayez pitié, vous tous et qui que vous soyez !
Les hideux châtiments, l’un sur l’autre broyés,
Roulent, submergeant tout, excepté les mémoires.
Parfois on voit passer dans ces profondeurs noires,
Comme un rayon lointain de l’éternel amour ;
Alors, l’hyène Atrée et le chacal Timour,
Et l’épine Caïphe et le roseau Pilate,
Le volcan Alaric à la gueule écarlate,
L’ours Henri huit, pour qui Morus en vain pria,
Le sanglier Selim et le porc Borgia,
Poussent des cris vers l’Être adorable ; et les bêtes
Qui portèrent jadis des mitres sur leurs têtes,
Les grains de sable rois, les brins d’herbe empereurs,
Tous les hideux orgueils et toutes les fureurs,
Se brisent ; la douceur saisit le plus farouche ;
Le chat lèche l’oiseau, l’oiseau baise la mouche ;
Le vautour dit dans l’ombre au passereau : Pardon !
Une caresse sort du houx et du chardon ;
Tous les rugissements se fondent en prières ;
On entend s’accuser de leurs forfaits les pierres ;
Tous ces sombres cachots qu’on appelle les fleurs
Tressaillent ; le rocher se met à fondre en pleurs ;
Des bras se lèvent hors de la tombe dormante ;
Le vent gémit, la nuit se plaint, l’eau se lamente,
Et, sous l’œil attendri qui regarde d’en haut,
Tout l’abîme n’est plus qu’un immense sanglot.
*
Espérez ! espérez ! espérez, misérables !
Pas de deuil infini, pas de maux incurables,
Pas d’enfer éternel !
Les douleurs vont à Dieu comme la flèche aux cibles ;
Les bonnes actions sont les gonds invisibles
De la porte du ciel.
Le deuil est la vertu, le remords est le pôle
Des monstres garrottés dont le gouffre est la geôle ;
Quand, devant Jéhovah,
Un vivant reste pur dans les ombres charnelles,
La mort, ange attendri, rapporte ses deux ailes
À l’homme qui s’en va.
Les enfers se refont édens ; c’est là leur tâche.
Tout globe est un oiseau que le mal tient et lâche.
Vivants, je vous le dis,
Les vertus, parmi vous, font ce labeur auguste
D’augmenter sur vos fronts le ciel ; quiconque est juste
Travaille au paradis.
L’heure approche. Espérez. Rallumez l’âme éteinte !
Aimez-vous ! aimez-vous ! car c’est la chaleur sainte,
C’est le feu du vrai jour.
Le sombre univers, froid, glacé, pesant, réclame
La sublimation de l’être par la flamme,
De l’homme par l’amour.
Déjà, dans l’océan d’ombre que Dieu domine,
L’archipel ténébreux des bagnes s’illumine ;
Dieu, c’est le grand aimant ;
Et les globes, ouvrant leur sinistre prunelle,
Vers les immensités de l’aurore éternelle
Se tournent lentement !
Oh ! comme vont chanter toutes les harmonies,
Comme rayonneront dans les sphères bénies
Les faces de clarté,
Comme les firmaments se fondront en délires,
Comme tressailliront toutes les grandes lyres
De la sérénité,
Quand, du monstre matière ouvrant toutes les serres,
Faisant évanouir en splendeurs les misères,
Changeant l’absinthe en miel,
Inondant de beauté la nuit diminuée,
Ainsi que le soleil tire à lui la nuée
Et l’emplit d’arcs-en-ciel,
Dieu, de son regard fixe attirant les ténèbres,
Voyant vers lui, du fond des cloaques funèbres
Où le mal le pria,
Monter l’énormité bégayant des louanges,
Fera rentrer, parmi les univers archanges,
L’univers paria !
On verra palpiter les fanges éclairées,
Et briller les laideurs les plus désespérées
Au faîte le plus haut,
L’araignée éclatante au seuil des bleus pilastres
Luire, et se redresser, portant des épis d’astres,
La paille du cachot !
La clarté montera dans tout comme une sève ;
On verra rayonner au front du bœuf qui rêve
Le céleste croissant ;
Le charnier chantera dans l’horreur qui l’encombre,
Et sur tous les fumiers apparaîtra dans l’ombre
Un Job resplendissant !
Ô disparition de l’antique anathème !
La profondeur disant à la hauteur : Je t’aime !
Ô retour du banni !
Quel éblouissement au fond des cieux sublimes !
Quel surcroît de clarté que l’ombre des abîmes
S’écriant : Sois béni !
On verra le troupeau des hydres formidables
Sortir, monter du fond des brumes insondables
Et se transfigurer ;
Des étoiles éclore aux trous noirs de leurs crânes,
Dieu juste ! et, par degrés devenant diaphanes,
Les monstres s’azurer !
Ils viendront, sans pouvoir ni parler ni répondre,
Éperdus ! on verra des auréoles fondre
Les cornes de leur front ;
Ils tiendront dans leur griffe, au milieu des cieux calmes,
Des rayons frissonnants semblables à des palmes ;
Les gueules baiseront !
Ils viendront ! ils viendront ! tremblants, brisés d’extase,
Chacun d’eux débordant de sanglots comme un vase,
Mais pourtant sans effroi ;
On leur tendra les bras de la haute demeure,
Et Jésus, se penchant sur Bélial qui pleure,
Lui dira : C’est donc toi !
Et vers Dieu par la main il conduira ce frère ;
Et, quand ils seront près des degrés de lumière
Par nous seuls aperçus,
Tous deux seront si beaux, que Dieu dont l’œil flamboie
Ne pourra distinguer, père ébloui de joie,
Bélial de Jésus !
Tout sera dit. Le mal expirera, les larmes
Tariront ; plus de fers, plus de deuils, plus d’alarmes ;
L’affreux gouffre inclément
Cessera d’être sourd, et bégaiera : Qu’entends-je ?
Les douleurs finiront dans toute l’ombre ; un ange
Criera : Commencement !
Jersey, 1855.