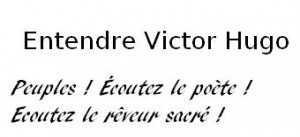VI. On est Tibère, on est Judas, on est Dracon…
On est Tibère, on est Judas, on est Dracon…
– Les références
Châtiments – Livre V – L’Autorité est sacrée ;
Collection Bouquins, Robert Laffont, Œuvres complètes de Victor Hugo, Poésie II, p 114.
On est Tibère, on est Judas, on est Dracon…
– Enregistrement
Je vous invite à écouter le poème On est Tibère, on est Judas, on est Dracon…
, du Livre V – L’Autorité est sacrée, du recueil Châtiments, de Victor Hugo.
Il est précédé de Ô drapeau de Wagram ! ô pays de Voltaire…
.
On est Tibère, on est Judas, on est Dracon…
On est Tibère, on est Judas, on est Dracon…
– Le texte
VI
On est Tibère, on est Judas, on est Dracon ;
Et l’on a Lambessa, n’ayant plus Montfaucon.
On forge pour le peuple une chaîne ; on enferme,
On exile, on proscrit le penseur libre et ferme ;
Tout succombe. On comprime élans, espoirs, regrets,
La liberté, le droit, l’avenir, le progrès,
Comme faisait Séjan, comme fit Louis onze,
Avec des lois de fer et des juges de bronze.
Puis, — c’est bien : — on s’endort, et le maître joyeux
Dit : l’homme n’a plus d’âme et le ciel n’a plus d’yeux.
Ô rêve des tyrans ! l’heure fuit, le temps marche,
Le grain croît dans la terre et l’eau coule sous l’arche.
Un jour vient où ces lois de silence et de mort,
Se rompant tout à coup comme sous un effort
Se rouvrent à grand bruit des portes mal fermées,
Emplissent la cité de torches enflammées.
Jersey, août 1853