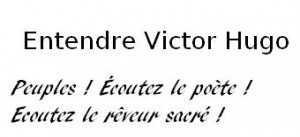XXVI. Jeune fille, l’amour…
Jeune fille, l’amour…
– Les références
Les Voix intérieures ;
Collection Bouquins, Robert Laffont, Œuvres complètes de Victor Hugo, Poésie I, p 886.
Jeune fille, l’amour…
– L’enregistrement
Je vous invite à écouter Jeune fille, l’amour…
, un poème du recueil Les Voix intérieures, de Victor Hugo.
Il est suivi de Après une lecture de Dante.
Jeune fille, l’amour…
Jeune fille, l’amour…
– Le texte
XXVI
Jeune fille, l’amour, c’est d’abord un miroir
Où la femme coquette et belle aime à se voir,
Et, gaie ou rêveuse, se penche ;
Puis, comme la vertu, quand il a votre cœur,
Il en chasse le mal et le vice moqueur,
Et vous fait l’âme pure et blanche ;
Puis on descend un peu, le pied vous glisse… — Alors
C’est un abîme ! en vain la main s’attache aux bords,
On s’en va dans l’eau qui tournoie ! —
L’amour est charmant, pur, et mortel. N’y crois pas !
Tel l’enfant, par un fleuve attiré pas à pas,
S’y mire, s’y lave et s’y noie.
Février 1837.