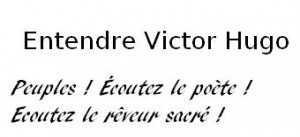Les 7,500,000 oui
Les 7,500,000 oui – Les références
L’Année terrible – Prologue ;
Collection Bouquins, Robert Laffont, Œuvres complètes de Victor Hugo, Poésie III, p 7.
Les 7,500,000 oui – L’enregistrement
Je vous invite à écouter Les 7,500,000 oui, un poème du recueil L’Année terrible, Prologue, de Victor Hugo.
Les 7,500,000 oui
Les 7,500,000 oui – Le texte
Les 7,500,000 oui
(Publié en mai 1870)
Quant à flatter la foule, ô mon esprit, non pas !
Ah ! le peuple est en haut, mais la foule est en bas.
La foule, c’est l’ébauche à côté du décombre ;
C’est le chiffre, ce grain de poussière du nombre ;
C’est le vague profil des ombres dans la nuit ;
La foule passe, crie, appelle, pleure, fuit ;
Versons sur ses douleurs la pitié fraternelle.
Mais quand elle se lève, ayant la force en elle,
On doit à la grandeur de la foule, au péril,
Au saint triomphe, au droit, un langage viril ;
Puisqu’elle est la maîtresse, il sied qu’on lui rappelle
Les lois d’en haut que l’âme au fond des cieux épèle,
Les principes sacrés, absolus, rayonnants ;
On ne baise ses pieds que nus, froids et saignants.
Ce n’est point pour ramper qu’on rêve aux solitudes.
La foule et le songeur ont des rencontres rudes ;
C’était avec un front où la colère bout
Qu’Ezéchiel criait aux ossements : Debout !
Moïse était sévère en rapportant les tables ;
Dante grondait. L’esprit des penseurs redoutables,
Grave, orageux, pareil au mystérieux vent
Soufflant du ciel profond dans le désert mouvant
Où Thèbes s’engloutit comme un vaisseau qui sombre,
Ce fauve esprit, chargé des balaiements de l’ombre,
A, certes, autre chose à faire que d’aller
Caresser, dans la nuit trop lente à s’étoiler,
Ce grand monstre de pierre accroupi qui médite,
Ayant en lui l’énigme adorable ou maudite ;
L’ouragan n’est pas tendre aux colosses émus ;
Ce n’est pas d’encensoirs que le sphinx est camus.
La vérité, voilà le grand encens austère
Qu’on doit à cette masse où palpite un mystère,
Et qui porte en son sein qu’un ventre appesantit
Le droit juste mêlé de l’injuste appétit.
Ô genre humain ! lumière et nuit ! chaos des âmes.
La multitude peut jeter d’augustes flammes.
Mais qu’un vent souffle, on voit descendre tout à coup
Du haut de l’honneur vierge au plus bas de l’égout
La foule, cette grande et fatale orpheline ;
Et cette Jeanne d’Arc se change en Messaline.
Ah ! quand Gracchus se dresse aux rostres foudroyants,
Quand Cynégire mord les navires fuyants,
Quand avec les Trois-cents, hommes faits ou pupilles,
Léonidas s’en va tomber aux Thermopyles,
Quand Botzaris surgit, quand Schwitz confédéré
Brise l’Autriche avec son dur bâton ferré,
Quand l’altier Winckelried, ouvrant ses bras épiques,
Meurt dans l’embrassement formidable des piques,
Quand Washington combat, quand Bolivar paraît,
Quand Pélage rugit au fond de sa forêt,
Quand Manin, réveillant les tombes, galvanise
Ce vieux dormeur d’airain, le lion de Venise,
Quand le grand paysan chasse à coups de sabot
Lautrec de Lombardie et de France Talbot,
Quand Garibaldi, rude au vil prêtre hypocrite,
Montre un héros d’Homère aux monts de Théocrite,
Et fait subitement flamboyer à côté
De l’Etna ton cratère, ô sainte Liberté !
Quand la Convention impassible tient tête
À trente rois, mêlés dans la même tempête,
Quand, liguée et terrible et rapportant la nuit,
Toute l’Europe accourt, gronde et s’évanouit
Comme aux pieds de la digue une vague écumeuse,
Devant les grenadiers pensifs de Sambre-et-Meuse,
C’est le peuple ; salut, ô peuple souverain !
Mais quand le lazzarone ou le transteverin
De quelque Sixte-Quint baise à genoux la crosse,
Quand la cohue inepte, insensée et féroce,
Étouffe sous ses flots, d’un vent sauvage émus,
L’honneur dans Coligny, la raison dans Ramus,
Quand un poing monstrueux, de l’ombre où l’horreur flotte
Sort, tenant aux cheveux la tête de Charlotte
Pâle du coup de hache et rouge du soufflet,
C’est la foule ; et ceci me heurte et me déplaît ;
C’est l’élément aveugle et confus ; c’est le nombre ;
C’est la sombre faiblesse et c’est la force sombre.
Et que de cette tourbe il nous vienne demain
L’ordre de recevoir un maître de sa main,
De souffler sur notre âme et d’entrer dans la honte,
Est-ce que vous croyez que nous en tiendrons compte ?
Certes, nous vénérons Sparte, Athènes, Paris,
Et tous les grands forums d’où partent les grands cris ;
Mais nous plaçons plus haut la conscience auguste.
Un monde, s’il a tort, ne pèse pas un juste ;
Tout un océan fou bat en vain un grand cœur.
Ô multitude, obscure et facile au vainqueur,
Dans l’instinct bestial trop souvent tu te vautres,
Et nous te résistons ! Nous ne voulons, nous autres,
Ayant Danton pour père et Hampden pour aïeul,
Pas plus du tyran Tous que du despote Un Seul.
Voici le peuple : il meurt, combattant magnifique,
Pour le progrès ; voici la foule : elle en trafique ;
Elle mange son droit d’aînesse en ce plat vil
Que Rome essuie et lave avec Ainsi-soit-il !
Voici le peuple : il prend la Bastille, il déplace
Toute l’ombre en marchant ; voici la populace :
Elle attend au passage Aristide, Jésus,
Zénon, Bruno, Colomb, Jeanne, et crache dessus.
Voici le peuple avec son épouse, l’idée ;
Voici la populace avec son accordée,
La guillotine. Eh bien, je choisis l’idéal.
Voici le peuple : il change avril en Floréal,
Il se fait république, il règne et délibère.
Voici la populace : elle accepte Tibère.
Je veux la république et je chasse César.
L’attelage ne peut amnistier le char.
Le droit est au-dessus de Tous ; nul vent contraire
Ne le renverse ; et Tous ne peuvent rien distraire
Ni rien aliéner de l’avenir commun.
Le peuple souverain de lui-même, et chacun
Son propre roi ; c’est là le droit. Rien ne l’entame.
Quoi ! l’homme que voilà, qui passe, aurait mon âme !
Honte ! il pourrait demain, par un vote hébété,
Prendre, prostituer, vendre ma liberté !
Jamais. La foule un jour peut couvrir le principe ;
Mais le flot redescend, l’écume se dissipe,
La vague en s’en allant laisse le droit à nu.
Qui donc s’est figuré que le premier venu
Avait droit sur mon droit ! qu’il fallait que je prisse
Sa bassesse pour joug, pour règle son caprice !
Que j’entrasse au cachot s’il entre au cabanon !
Que je fusse forcé de me faire chaînon
Parce qu’il plaît à tous de se changer en chaîne !
Que le pli du roseau devînt la loi du chêne !
Ah ! le premier venu, bourgeois ou paysan,
L’un égoïste et l’autre aveugle, parlons-en !
Les révolutions, durables, quoi qu’il fasse,
Ont pour cet inconnu qui jette à leur surface
Tantôt de l’infamie et tantôt de l’honneur,
Le dédain qu’a le mur pour le badigeonneur.
Voyez-le, ce passant de Carthage ou d’Athènes
Ou de Rome, pareil à l’eau qui des fontaines
Tombe aux pavés, s’en va dans le ruisseau fatal,
Et devient boue après avoir été cristal.
Cet homme étonne, après tant de jours beaux et rudes,
Par son indifférence au fond des turpitudes,
Ceux mêmes qu’ont d’abord éblouis ses vertus ;
Il est Falstaff après avoir été Brutus ;
Il entre dans l’orgie en sortant de la gloire ;
Allez lui demander s’il sait sa propre histoire,
Ce qu’était Washington ou ce qu’a fait Bara,
Son cœur mort ne bat plus aux noms qu’il adora.
Naguère il restaurait les vieux cultes, les bustes
De ses héros tombés, de ses aïeux robustes,
Phocion expiré, Lycurgue enseveli,
Riego mort, et voyez maintenant quel oubli !
Il fut pur, et s’en lave ; il fut sain, et l’ignore ;
Il ne s’aperçoit pas même qu’il déshonore
Par l’œuvre d’aujourd’hui son ouvrage d’hier ;
Il devient lâche et vil, lui qu’on a vu si fier ;
Et, sans que rien en lui se révolte et proteste,
Barbouille une taverne immonde avec le reste
De la chaux dont il vient de blanchir un tombeau.
Son piédestal souillé se change en escabeau ;
L’honneur lui semble lourd, rouillé, gothique ; il raille
Cette armure sévère, et dit : Vieille ferraille !
Jadis des fiers combats il a joué le jeu ;
Duperie. Il fut grand, et s’en méprise un peu.
Il est sa propre insulte et sa propre ironie.
Il est si bien esclave à présent qu’il renie,
Indigné, son passé, perdu dans la vapeur ;
Et quant à sa bravoure ancienne, il en a peur.
Mais quoi, reproche-t-on à la mer qui s’écroule
L’onde, et ses millions de têtes à la foule ?
Que sert de chicaner ses erreurs, son chemin,
Ses retours en arrière, à ce nuage humain,
À ce grand tourbillon des vivants, incapable
Hélas ! d’être innocent comme d’être coupable ?
À quoi bon ? Quoique vague, obscur, sans point d’appui,
Il est utile ; et, tout en flottant devant lui,
Il a pour fonction, à Paris comme à Londre,
De faire le progrès, et d’autres d’en répondre ;
La république anglaise expire, se dissout,
Tombe, et laisse Milton derrière elle debout ;
La foule a disparu, mais le penseur demeure ;
C’est assez pour que tout germe et que rien ne meure.
Dans les chutes du droit rien n’est désespéré.
Qu’importe le méchant heureux, fier, vénéré ?
Tu fais des lâchetés, ciel profond ; tu succombes,
Rome ; la liberté va vivre aux catacombes ;
Les dieux sont au vainqueur, Caton reste aux vaincus.
Kosciusko surgit des os de Galgacus.
On interrompt Jean Huss ; soit ; Luther continue.
La lumière est toujours par quelque bras tenue ;
On mourra, s’il le faut, pour prouver qu’on a foi ;
Et volontairement, simplement, sans effroi,
Des justes sortiront de la foule asservie,
Iront droit au sépulcre et quitteront la vie,
Ayant plus de dégoût des hommes que des vers.
Oh ! ces grands Régulus, de tant d’oubli couverts,
Arria, Porcia, ces héros qui sont femmes,
Tous ces courages purs, toutes ces fermes âmes,
Curtius, Adam Lux, Thraséas calme et fort
Ce puissant Condorcet, ce stoïque Chamfort,
Comme ils ont chastement quitté la terre indigne !
Ainsi fuit la colombe, ainsi plane le cygne,
Ainsi l’aigle s’en va du marais des serpents.
Léguant l’exemple à tous, aux méchants, aux rampants,
À l’égoïsme, au crime, aux lâches cœurs pleins d’ombre,
Ils se sont endormis dans le grand sommeil sombre ;
Ils ont fermé les yeux ne voulant plus rien voir ;
Ces martyrs généreux ont sacré le devoir,
Puis se sont étendus sur la funèbre couche ;
Leur mort à la vertu donne un baiser farouche.
Ô caresse sublime et sainte du tombeau
Au grand, au pur, au bon, à l’idéal, au beau !
En présence de ceux qui disent : Rien n’est juste !
Devant tout ce qui trouble et nuit, devant Locuste,
Devant Pallas, devant Carrier, devant Sanchez,
Devant les appétits sur le néant penchés,
Les sophistes niant, les cœurs faux, les fronts vides,
Quelle affirmation que ces grands suicides !
Ah ! quand tout paraît mort dans le monde vivant,
Quand on ne sait s’il faut avancer plus avant,
Quand pas un cri du fond des masses ne s’élance,
Quand l’univers n’est plus qu’un doute et qu’un silence,
Celui qui dans l’enceinte où sont les noirs fossés
Ira chercher quelqu’un de ces purs trépassés
Et qui se collera l’oreille contre terre,
Et qui demandera : Faut-il croire, ombre austère ?
Faut-il marcher, héros sous la cendre enfoui ?
Entendra ce tombeau dire à voix haute : Oui.
Oh ! qu’est-ce donc qui tombe autour de nous dans l’ombre ?
Que de flocons de neige ! En savez-vous le nombre ?
Comptez les millions et puis les millions !
Nuit noire ! on voit rentrer au gîte les lions ;
On dirait que la vie éternelle recule ;
La neige fait, niveau hideux du crépuscule,
On ne sait quel sinistre abaissement des monts ;
Nous nous sentons mourir si nous nous endormons ;
Cela couvre les champs, cela couvre les villes ;
Cela blanchit l’égout masquant ses bouches viles ;
La lugubre avalanche emplit le ciel terni ;
Sombre épaisseur de glace ! Est-ce que c’est fini ?
On ne distingue plus son chemin ; tout est piège.
Soit.
Que restera-t-il de toute cette neige,
Voile froid de la terre au suaire pareil,
Demain, une heure après le lever du soleil ?