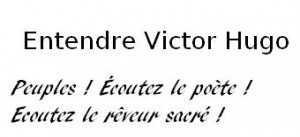III. Puissance égale bonté
Puissance égale bonté – Les références
La Légende des siècles – Première série – I – D’Ève à Jésus ;
Collection Bouquins, Robert Laffont, Œuvres complètes de Victor Hugo – Poésie II, p 578 ;
Autre référence : Collection Poésie/Gallimard, La Légende des siècles – II – D’Ève à Jésus, p. 32.
Puissance égale bonté – L’enregistrement
Je vous invite à écouter Puissance égale bonté, un poème de La Légende des siècles – Première série, D’Ève à Jésus, de Victor Hugo.
Il est précédé du poème II. La conscience et suivi de IV. Les lions.
Puissance égale bonté
Puissance égale bonté – Le texte
III
Puissance égale bonté
Au commencement, Dieu vit un jour dans l’espace
Iblis venir à lui ; Dieu dit : « Veux-tu ta grâce ?
— Non, dit le Mal. — Alors que me demandes-tu ?
— Dieu, répondit Iblis de ténèbres vêtu,
Joutons à qui créera la chose la plus belle. »
L’Être dit : « J’y consens. — Voici, dit le Rebelle :
Moi, je prendrai ton œuvre et la transformerai.
Toi, tu féconderas ce que je t’offrirai ;
Et chacun de nous deux soufflera son génie
Sur la chose par l’autre apportée et fournie.
— Soit. Que te faut-il ? Prends, dit l’Être avec dédain.
— La tête du cheval et les cornes du daim.
— Prends. » Le monstre hésitant que la brume enveloppe
Reprit : « J’aimerais mieux celle de l’antilope.
— Va, prends. » Iblis entra dans son antre et forgea.
Puis il dressa le front. « Est-ce fini déjà ?
— Non. — Te faut-il encor quelque chose ? dit l’Être.
— Les yeux de l’éléphant, le cou du taureau, maître.
— Prends. — Je demande, en outre, ajouta le Rampant,
Le ventre du cancer, les anneaux du serpent,
Les cuisses du chameau, les pattes de l’autruche.
— Prends. » Ainsi qu’on entend l’abeille dans la ruche,
On entendait aller et venir dans l’enfer
Le démon remuant des enclumes de fer.
Nul regard ne pouvait voir à travers la nue
Ce qu’il faisait au fond de la cave inconnue.
Tout à coup, se tournant vers l’Être, Iblis hurla :
« Donne-moi la couleur de l’or. » Dieu dit : « Prends-la. »
Et, grondant et râlant comme un bœuf qu’on égorge,
Le démon se remit à battre dans sa forge ;
Il frappait du ciseau, du pilon, du maillet,
Et toute la caverne horrible tressaillait ;
Les éclairs des marteaux faisaient une tempête ;
Ses yeux ardents semblaient deux braises dans sa tête ;
Il rugissait ; le feu lui sortait des naseaux,
Avec un bruit pareil au bruit des grandes eaux
Dans la saison livide où la cigogne émigre.
Dieu dit : « Que te faut-il encor ? — Le bond du tigre.
— Prends. — C’est bien, dit Iblis debout dans son volcan.
— Viens m’aider à souffler, » dit-il à l’ouragan.
L’âtre flambait ; Iblis, suant à grosses gouttes,
Se courbait, se tordait, et, sous les sombres voûtes,
On ne distinguait rien qu’une sombre rougeur
Empourprant le profil du monstrueux forgeur.
Et l’ouragan l’aidait, étant démon lui-même.
L’Être, parlant du haut du firmament suprême,
Dit : « Que veux-tu de plus ? » Et le grand paria,
Levant sa tête énorme et triste, lui cria :
« Le poitrail du lion et les ailes de l’aigle. »
Et Dieu jeta, du fond des éléments qu’il règle,
À l’ouvrier d’orgueil et de rébellion
L’aile de l’aigle avec le poitrail du lion.
Et le démon reprit son œuvre sous les voiles.
« Quelle hydre fait-il donc ? » demandaient les étoiles.
Et le monde attendait, grave, inquiet, béant,
Le colosse qu’allait enfanter ce géant ;
Soudain, on entendit dans la nuit sépulcrale
Comme un dernier effort jetant un dernier râle ;
L’Etna, fauve atelier du forgeron maudit,
Flamboya ; le plafond de l’enfer se fendit,
Et, dans une clarté blême et surnaturelle,
On vit des mains d’Iblis jaillir la sauterelle.
Et l’infirme effrayant, l’être ailé, mais boiteux,
Vit sa création et n’en fut pas honteux,
L’avortement étant l’habitude de l’ombre.
Il sortit à mi-corps de l’éternel décombre,
Et, croisant ses deux bras, arrogant, ricanant,
Cria dans l’infini : « Maître, à toi maintenant ! »
Et ce fourbe, qui tend à Dieu même une embûche,
Reprit : « Tu m’as donné l’éléphant et l’autruche,
Et l’or pour dorer tout ; et ce qu’ont de plus beau
Le chameau, le cheval, le lion, le taureau,
Le tigre et l’antilope, et l’aigle et la couleuvre ;
C’est mon tour de fournir la matière à ton œuvre ;
Voici tout ce que j’ai. Je te le donne. Prends. »
Dieu, pour qui les méchants mêmes sont transparents,
Tendit sa grande main de lumière baignée
Vers l’ombre, et le démon lui donna l’araignée.
Et Dieu prit l’araignée et la mit au milieu
Du gouffre qui n’était pas encor le ciel bleu ;
Et l’Esprit regarda la bête ; sa prunelle,
Formidable, versait la lueur éternelle ;
Le monstre, si petit qu’il semblait un point noir,
Grossit alors, et fut soudain énorme à voir ;
Et Dieu le regardait de son regard tranquille ;
Une aube étrange erra sur cette forme vile ;
L’affreux ventre devint un globe lumineux ;
Et les pattes, changeant en sphères d’or leurs nœuds,
S’allongèrent dans l’ombre en grands rayons de flamme ;
Iblis leva les yeux, et tout à coup l’infâme,
Ébloui, se courba sous l’abîme vermeil ;
Car Dieu, de l’araignée, avait fait le soleil.