I. Le sacre de la femme
Le sacre de la femme – Les références
La Légende des siècles – Première série – I – D’Ève à Jésus ;
Collection Bouquins, Robert Laffont, Œuvres complètes de Victor Hugo – Poésie II, p 571 ;
Autre référence : Collection Poésie/Gallimard, La Légende des siècles – II – D’Ève à Jésus, p. 23.
Le sacre de la femme – L’enregistrement
Je vous invite à écouter Le sacre de la femme, premier poème du cycle D’Ève à Jésus, de La Légende des siècles – Première série, de Victor Hugo.
Il est suivi du poème II. La conscience.
Le sacre de la femme
Le sacre de la femme – Le texte
I
Le sacre de la femme
I
L’aurore apparaissait ; quelle aurore ? Un abîme
D’éblouissement, vaste, insondable, sublime ;
Une ardente lueur de paix et de bonté.
C’était aux premiers temps du globe ; et la clarté
Brillait sereine au front du ciel inaccessible,
Étant tout ce que Dieu peut avoir de visible ;
Tout s’illuminait, l’ombre et le brouillard obscur ;
Des avalanches d’or s’écroulaient dans l’azur ;
Le jour en flamme, au fond de la terre ravie,
Embrasait les lointains splendides de la vie ;
Les horizons pleins d’ombre et de rocs chevelus,
Et d’arbres effrayants que l’homme ne voit plus,
Luisaient comme le songe et comme le vertige,
Dans une profondeur d’éclair et de prodige ;
L’Éden pudique et nu s’éveillait mollement ;
Les oiseaux gazouillaient un hymne si charmant,
Si frais, si gracieux, si suave et si tendre,
Que les anges distraits se penchaient pour l’entendre ;
Le seul rugissement du tigre était plus doux ;
Les halliers où l’agneau paissait avec les loups,
Les mers où l’hydre aimait l’alcyon, et les plaines
Où les ours et les daims confondaient leurs haleines,
Hésitaient, dans le chœur des concerts infinis,
Entre le cri de l’antre et la chanson des nids.
La prière semblait à la clarté mêlée ;
Et sur cette nature encore immaculée
Qui du verbe éternel avait gardé l’accent,
Sur ce monde céleste, angélique, innocent,
Le matin, murmurant une sainte parole,
Souriait, et l’aurore était une auréole.
Tout avait la figure intègre du bonheur ;
Pas de bouche d’où vînt un souffle empoisonneur ;
Pas un être qui n’eût sa majesté première ;
Tout ce que l’infini peut jeter de lumière
Éclatait pêle-mêle à la fois dans les airs ;
Le vent jouait avec cette gerbe d’éclairs
Dans le tourbillon libre et fuyant des nuées ;
L’enfer balbutiait quelques vagues huées
Qui s’évanouissaient dans le grand cri joyeux
Des eaux, des monts, des bois, de la terre et des cieux !
Les vents et les rayons semaient de tels délires
Que les forêts vibraient comme de grandes lyres ;
De l’ombre à la clarté, de la base au sommet,
Une fraternité vénérable germait ;
L’astre était sans orgueil et le ver sans envie ;
On s’adorait d’un bout à l’autre de la vie ;
Une harmonie égale à la clarté, versant
Une extase divine au globe adolescent,
Semblait sortir du cœur mystérieux du monde ;
L’herbe en était émue, et le nuage, et l’onde,
Et même le rocher qui songe et qui se tait ;
L’arbre, tout pénétré de lumière, chantait ;
Chaque fleur, échangeant son souffle et sa pensée
Avec le ciel serein d’où tombe la rosée,
Recevait une perle et donnait un parfum ;
L’Être resplendissait, Un dans Tout, Tout dans Un ;
Le paradis brillait sous les sombres ramures
De la vie ivre d’ombre et pleine de murmures,
Et la lumière était faite de vérité ;
Et tout avait la grâce, ayant la pureté ;
Tout était flamme, hymen, bonheur, douceur, clémence,
Tant ces immenses jours avaient une aube immense !
II
Ineffable lever du premier rayon d’or !
Du jour éclairant tout sans rien savoir encor !
Ô matin des matins ! amour ! joie effrénée
De commencer le temps, l’heure, le mois, l’année !
Ouverture du monde ! instant prodigieux !
La nuit se dissolvait dans les énormes cieux
Où rien ne tremble, où rien ne pleure, où rien ne souffre ;
Autant que le chaos la lumière était gouffre ;
Dieu se manifestait dans sa calme grandeur,
Certitude pour l’âme et pour les yeux splendeur ;
De faîte en faîte, au ciel et sur terre, et dans toutes
Les épaisseurs de l’être aux innombrables voûtes,
On voyait l’évidence adorable éclater ;
Le monde s’ébauchait ; tout semblait méditer ;
Les types primitifs, offrant dans leur mélange
Presque la brute informe et rude et presque l’ange,
Surgissaient, orageux, gigantesques, touffus ;
On sentait tressaillir sous leurs groupes confus
La terre, inépuisable et suprême matrice ;
La création sainte, à son tour créatrice,
Modelait vaguement des aspects merveilleux,
Faisait sortir l’essaim des êtres fabuleux
Tantôt des bois, tantôt des mers, tantôt des nues,
Et proposait à Dieu des formes inconnues
Que le temps, moissonneur pensif, plus tard changea ;
On sentait sourdre, et vivre, et végéter déjà
Tous les arbres futurs, pins, érables, yeuses,
Dans des verdissements de feuilles monstrueuses ;
Une sorte de vie excessive gonflait
La mamelle du monde au mystérieux lait ;
Tout semblait presque hors de la mesure éclore ;
Comme si la nature, en étant proche encore,
Eût pris, pour ses essais sur la terre et les eaux,
Une difformité splendide au noir chaos.
Les divins paradis, pleins d’une étrange sève,
Semblent au fond des temps reluire dans le rêve,
Et, pour nos yeux obscurs, sans idéal, sans foi,
Leur extase aujourd’hui serait presque l’effroi ;
Mais qu’importe à l’abîme, à l’âme universelle
Qui dépense un soleil au lieu d’une étincelle,
Et qui, pour y pouvoir poser l’ange azuré,
Fait croître jusqu’aux cieux l’Éden démesuré !
Jours inouïs ! le bien, le beau, le vrai, le juste,
Coulaient dans le torrent, frissonnaient dans l’arbuste ;
L’aquilon louait Dieu de sagesse vêtu ;
L’arbre était bon ; la fleur était une vertu ;
C’est trop peu d’être blanc, le lys était candide ;
Rien n’avait de souillure et rien n’avait de ride ;
Jours purs ! rien ne saignait sous l’ongle et sous la dent ;
La bête heureuse était l’innocence rôdant ;
Le mal n’avait encor rien mis de son mystère
Dans le serpent, dans l’aigle altier, dans la panthère ;
Le précipice ouvert dans l’animal sacré
N’avait pas d’ombre, étant jusqu’au fond éclairé ;
La montagne était jeune et la vague était vierge ;
Le globe, hors des mers dont le flot le submerge,
Sortait beau, magnifique, aimant, fier, triomphant,
Et rien n’était petit quoique tout fût enfant ;
La terre avait, parmi ses hymnes d’innocence,
Un étourdissement de sève et de croissance ;
L’instinct fécond faisait rêver l’instinct vivant ;
Et, répandu partout, sur les eaux, dans le vent,
L’amour épars flottait comme un parfum s’exhale ;
La nature riait, naïve et colossale ;
L’espace vagissait ainsi qu’un nouveau-né.
L’aube était le regard du soleil étonné.
III
Or, ce jour-là, c’était le plus beau qu’eût encore
Versé sur l’univers la radieuse aurore ;
Le même séraphique et saint frémissement
Unissait l’algue à l’onde et l’être à l’élément ;
L’éther plus pur luisait dans les cieux plus sublimes ;
Les souffles abondaient plus profonds sur les cimes ;
Les feuillages avaient de plus doux mouvements ;
Et les rayons tombaient caressants et charmants
Sur un frais vallon vert, où, débordant d’extase,
Adorant ce grand ciel que la lumière embrase,
Heureux d’être, joyeux d’aimer, ivres de voir,
Dans l’ombre, au bord d’un lac, vertigineux miroir,
Étaient assis, les pieds effleurés par la lame,
Le premier homme auprès de la première femme.
L’époux priait, ayant l’épouse à son côté.
IV
Ève offrait au ciel bleu la sainte nudité ;
Ève blonde admirait l’aube, sa sœur vermeille.
Chair de la femme ! argile idéale ! ô merveille !
Ô pénétration sublime de l’esprit
Dans le limon que l’Être ineffable pétrit !
Matière où l’âme brille à travers son suaire !
Boue où l’on voit les doigts du divin statuaire !
Fange auguste appelant le baiser et le cœur,
Si sainte, qu’on ne sait, tant l’amour est vainqueur,
Tant l’âme est vers ce lit mystérieux poussée,
Si cette volupté n’est pas une pensée,
Et qu’on ne peut, à l’heure où les sens sont en feu,
Étreindre la beauté sans croire embrasser Dieu !
Ève laissait errer ses yeux sur la nature.
Et, sous les verts palmiers à la haute stature,
Autour d’Ève, au-dessus de sa tête, l’œillet
Semblait songer, le bleu lotus se recueillait,
Le frais myosotis se souvenait ; les roses
Cherchaient ses pieds avec leurs lèvres demi-closes ;
Un souffle fraternel sortait du lys vermeil ;
Comme si ce doux être eût été leur pareil,
Comme si de ces fleurs, ayant toutes une âme,
La plus belle s’était épanouie en femme.
V
Pourtant, jusqu’à ce jour, c’était Adam, l’élu
Qui dans le ciel sacré le premier avait lu,
C’était le Marié tranquille et fort, que l’ombre
Et la lumière, et l’aube, et les astres sans nombre,
Et les bêtes des bois, et les fleurs du ravin
Suivaient ou vénéraient comme l’aîné divin,
Comme le front ayant la lueur la plus haute ;
Et, quand tous deux, la main dans la main, côte à côte,
Erraient dans la clarté de l’Éden radieux,
La nature sans fond, sous ses millions d’yeux,
À travers les rochers, les rameaux, l’onde et l’herbe,
Couvait, avec amour pour le couple superbe,
Avec plus de respect pour l’homme, être complet,
Ève qui regardait, Adam qui contemplait.
Mais, ce jour-là, ces yeux innombrables qu’entr’ouvre
L’infini sous les plis du voile qui le couvre,
S’attachaient sur l’épouse et non pas sur l’époux,
Comme si, dans ce jour religieux et doux,
Béni parmi les jours et parmi les aurores,
Aux nids ailés perdus sous les branches sonores,
Au nuage, aux ruisseaux, aux frissonnants essaims,
Aux bêtes, aux cailloux, à tous ces êtres saints
Que de mots ténébreux la terre aujourd’hui nomme,
La femme eût apparu plus auguste que l’homme !
VI
Pourquoi ce choix ? pourquoi cet attendrissement
Immense du profond et divin firmament ?
Pourquoi tout l’univers penché sur une tête ?
Pourquoi l’aube donnant à la femme une fête ?
Pourquoi ces chants ? Pourquoi ces palpitations
Des flots dans plus de joie et dans plus de rayons ?
Pourquoi partout l’ivresse et la hâte d’éclore,
Et les antres heureux de s’ouvrir à l’aurore,
Et plus d’encens sur terre et plus de flamme aux cieux ?
Le beau couple innocent songeait silencieux.
VII
Cependant la tendresse inexprimable et douce
De l’astre, du vallon, du lac, du brin de mousse,
Tressaillait plus profonde à chaque instant autour
D’Ève, que saluait du haut des cieux le jour ;
Le regard qui sortait des choses et des êtres,
Des flots bénis, des bois sacrés, des arbres prêtres,
Se fixait, plus pensif de moment en moment,
Sur cette femme au front vénérable et charmant ;
Un long rayon d’amour lui venait des abîmes,
De l’ombre, de l’azur, des profondeurs, des cimes,
De la fleur, de l’oiseau chantant, du roc muet.
Et, pâle, Ève sentit que son flanc remuait.
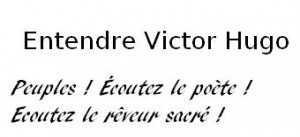











Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !