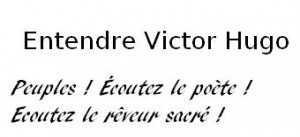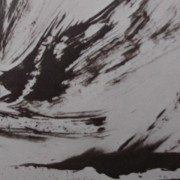IV. Les lions
Les lions – Les références
La Légende des siècles – Première série – I – D’Ève à Jésus ;
Collection Bouquins, Robert Laffont, Œuvres complètes de Victor Hugo – Poésie II, p 580.
Autre référence : Collection Poésie/Gallimard, La Légende des siècles, p. 34.
Les lions – L’enregistrement
Je vous invite à écouter Les lions, un poème de La Légende des siècles – Première Série, I – D’Ève à Jésus, de Victor Hugo.
Il est précédé du poème III. Puissance égale bonté et suivi de V. Le temple.
Les lions
Les lions – Le texte
IV
Les lions
Les lions dans la fosse étaient sans nourriture.
Captifs, ils rugissaient vers la grande nature
Qui prend soin de la brute au fond des antres sourds.
Les lions n’avaient pas mangé depuis trois jours.
Ils se plaignaient de l’homme, et, pleins de sombres haines,
À travers leur plafond de barreaux et de chaînes,
Regardaient du couchant la sanglante rougeur ;
Leur voix grave effrayait au loin le voyageur
Marchant à l’horizon dans les collines bleues.
Tristes, ils se battaient le ventre de leurs queues ;
Et les murs du caveau tremblaient, tant leurs yeux roux
À leur gueule affamée ajoutaient de courroux !
La fosse était profonde ; et, pour cacher leur fuite,
Og et ses vastes fils l’avaient jadis construite ;
Ces enfants de la terre avaient creusé pour eux
Ce palais colossal dans le roc ténébreux ;
Leurs têtes en ayant crevé la large voûte,
La lumière y tombait et s’y répandait toute,
Et ce cachot de nuit pour dôme avait l’azur.
Nabuchodonosor, qui régnait dans Assur,
En avait fait couvrir d’un dallage le centre ;
Et ce roi fauve avait trouvé bon que cet antre,
Qui jadis vit les Chams et les Deucalions,
Bâti par les géants, servît pour les lions.
Ils étaient quatre, et tous affreux. Une litière
D’ossements tapissait le vaste bestiaire ;
Les rochers étageaient leur ombre au-dessus d’eux ;
Ils marchaient, écrasant sur le pavé hideux
Des carcasses de bête et des squelettes d’homme.
Le premier arrivait du désert de Sodome ;
Jadis, quand il avait sa fauve liberté,
Il habitait le Sin, tout à l’extrémité
Du silence terrible et de la solitude ;
Malheur à qui tombait sous sa patte au poil rude !
Et c’était un lion des sables.
Le second
Sortait de la forêt de l’Euphrate fécond ;
Naguère, en le voyant vers le fleuve descendre,
Tout tremblait ; on avait eu du mal à le prendre,
Car il avait fallu les meutes de deux rois ;
Il grondait ; et c’était une bête des bois.
Et le troisième était un lion des montagnes.
Jadis il avait l’ombre et l’horreur pour compagnes ;
Dans ce temps-là, parfois, vers les ravins bourbeux
Se ruaient des galops de moutons et de bœufs ;
Tous fuyaient, le pasteur, le guerrier et le prêtre ;
Et l’on voyait sa face effroyable apparaître.
Le quatrième, monstre épouvantable et fier,
Était un grand lion des plages de la mer.
Il rôdait près des flots avant son esclavage.
Gur, cité forte, était alors sur le rivage ;
Ses toits fumaient ; son port abritait un amas
De navires mêlant confusément leurs mâts ;
Le paysan portant son gomor plein de manne
S’y rendait ; le prophète y venait sur son âne ;
Ce peuple était joyeux comme un oiseau lâché ;
Gur avait une place avec un grand marché,
Et l’Abyssin venait y vendre des ivoires ;
L’Amorrhéen, de l’ambre et des chemises noires ;
Ceux d’Ascalon, du beurre, et ceux d’Aser, du blé.
Du vol de ses vaisseaux l’abîme était troublé.
Or, ce lion était gêné par cette ville ;
Il trouvait, quand le soir il songeait immobile,
Qu’elle avait trop de peuple et faisait trop de bruit.
Gur était très-farouche et très-haute ; la nuit,
Trois lourds barreaux fermaient l’entrée inabordable ;
Entre chaque créneau se dressait, formidable,
Une corne de buffle ou de rhinocéros ;
Le mur était solide et droit comme un héros ;
Et l’Océan roulait à vagues débordées
Dans le fossé, profond de soixante coudées.
Au lieu de dogues noirs jappant dans le chenil,
Deux dragons monstrueux pris dans les joncs du Nil
Et dressés par un mage à la garde servile,
Veillaient des deux côtés de la porte de ville.
Or, le lion s’était une nuit avancé,
Avait franchi d’un bond le colossal fossé,
Et broyé, furieux, entre ses dents barbares,
La porte de la ville avec ses triples barres,
Et, sans même les voir, mêlé les deux dragons
Au vaste écrasement des verrous et des gonds ;
Et, quand il s’en était retourné vers la grève,
De la ville et du peuple il ne restait qu’un rêve,
Et, pour loger le tigre et nicher les vautours,
Quelques larves de murs sous des spectres de tours.
Celui-là se tenait accroupi sur le ventre.
Il ne rugissait pas, il bâillait ; dans cet antre
Où l’homme misérable avait le pied sur lui,
Il dédaignait la faim, ne sentant que l’ennui.
Les trois autres allaient et venaient ; leur prunelle,
Si quelque oiseau battait leurs barreaux de son aile,
Le suivait ; et leur faim bondissait, et leur dent
Mâchait l’ombre à travers leur cri rauque et grondant.
Soudain, dans l’angle obscur de la lugubre étable,
La grille s’entr’ouvrit ; sur le seuil redoutable,
Un homme que poussaient d’horribles bras tremblants,
Apparut ; il était vêtu de linceuls blancs ;
La grille referma ses deux battants funèbres ;
L’homme avec les lions resta dans les ténèbres.
Les monstres, hérissant leur crinière, écumant,
Se ruèrent sur lui, poussant ce hurlement
Effroyable, où rugit la haine et le ravage
Et toute la nature irritée et sauvage
Avec son épouvante et ses rébellions ;
Et l’homme dit : « La paix soit avec vous, lions ! »
L’homme dressa la main ; les lions s’arrêtèrent.
Les loups qui font la guerre aux morts et les déterrent,
Les ours au crâne plat, les chacals convulsifs
Qui pendant le naufrage errent sur les récifs,
Sont féroces ; l’hyène infâme est implacable ;
Le tigre attend sa proie et d’un seul bond l’accable ;
Mais le puissant lion, qui fait de larges pas,
Parfois lève sa griffe et ne la baisse pas,
Étant le grand rêveur solitaire de l’ombre.
Et les lions, groupés dans l’immense décombre,
Se mirent à parler entre eux, délibérant ;
On eût dit des vieillards réglant un différend
Au froncement pensif de leurs moustaches blanches.
Un arbre mort pendait, tordant sur eux ses branches.
Et, grave, le lion des sables dit : « Lions,
Quand cet homme est entré, j’ai cru voir les rayons
De midi dans la plaine où l’ardent semoun passe,
Et j’ai senti le souffle énorme de l’espace ;
Cet homme vient à nous de la part du désert. »
Le lion des bois dit : « Autrefois, le concert
Du figuier, du palmier, du cèdre et de l’yeuse,
Emplissait jour et nuit ma caverne joyeuse ;
Même à l’heure où l’on sent que le monde se tait,
Le grand feuillage vert autour de moi chantait.
Quand cet homme a parlé, sa voix m’a semblé douce
Comme le bruit qui sort des nids d’ombre et de mousse ;
Cet homme vient à nous de la part des forêts. »
Et celui qui s’était approché le plus près,
Le lion noir des monts dit : « Cet homme ressemble
Au Caucase, où jamais une roche ne tremble ;
Il a la majesté de l’Atlas ; j’ai cru voir,
Quand son bras s’est levé, le Liban se mouvoir
Et se dresser, jetant l’ombre immense aux campagnes ;
Cet homme vient à nous de la part des montagnes. »
Le lion qui, jadis, au bord des flots rôdant,
Rugissait aussi haut que l’Océan grondant,
Parla le quatrième, et dit : « Fils, j’ai coutume,
En voyant la grandeur, d’oublier l’amertume,
Et c’est pourquoi j’étais le voisin de la mer.
J’y regardais — laissant les vagues écumer —
Apparaître la lune et le soleil éclore,
Et le sombre infini sourire dans l’aurore ;
Et j’ai pris, ô lions, dans cette intimité,
L’habitude du gouffre et de l’éternité ;
Or, sans savoir le nom dont la terre le nomme,
J’ai vu luire le ciel dans les yeux de cet homme ;
Cet homme au front serein vient de la part de Dieu. »
Quand la nuit eut noirci le grand firmament bleu,
Le gardien voulut voir la fosse, et cet esclave,
Collant sa face pâle aux grilles de la cave,
Dans la profondeur vague aperçut Daniel
Qui se tenait debout et regardait le ciel,
Et songeait, attentif aux étoiles sans nombre,
Pendant que les lions léchaient ses pieds dans l’ombre.