La ville disparue
La ville disparue – Les références
La Légende des siècles – Nouvelle Série – La Ville disparue ;
Collection Bouquins, Robert Laffont, Œuvres complètes de Victor Hugo, Poésie III, p 229.
Autre référence : Collection Poésie/Gallimard, La Légende des siècles, p. 74.
La ville disparue – L’enregistrement
Je vous invite à écouter La ville disparue, un poème du recueil La Légende des siècles – Nouvelle Série, de Victor Hugo.
La ville disparue
La ville disparue – Le texte
La ville disparue
Peuple, l’eau n’est jamais sans rien faire. Mille ans
Avant Adam, qui semble un spectre en cheveux blancs,
Notre aïeul, c’est du moins ainsi que tu le nommes,
Quand les géants étaient encor mêlés aux hommes,
Dans des temps dont jamais personne ne parla,
Une ville bâtie en briques était là
Où sont ces flots qu’agite un aquilon immense
Et cette ville était un lieu plein de démence
Que parfois menaçait de loin un blême éclair.
On voyait une plaine où l’on voit une mer ;
Alors c’étaient des chars qui passaient, non des barques ;
Les ouragans ont pris la place des monarques ;
Car pour faire un désert, Dieu, maître des vivants,
Commence par les rois et finit par les vents.
Ce peuple, voix, rumeurs, fourmillement de têtes,
Troupeau d’âmes, ému par les deuils et les fêtes,
Faisait le bruit que fait dans l’orage l’essaim,
Point inquiet d’avoir l’Océan pour voisin.
Donc cette ville avait des rois ; ces rois superbes
Avaient sous eux les fronts comme un faucheur les herbes.
Étaient-ils méchants ? Non. Ils étaient rois. Un roi
C’est un homme trop grand que trouble un vague effroi,
Qui, faisant plus de mal pour avoir plus de joie,
Chez les bêtes de somme est la bête de proie ;
Mais ce n’est pas sa faute, et le sage est clément.
Un roi serait meilleur s’il naissait autrement ;
L’homme est homme toujours ; les crimes du despote
Sont faits par sa puissance, ombre où son âme flotte,
Par la pourpre qu’il traîne et dont on le revêt,
Et l’esclave serait tyran s’il le pouvait.
Donc cette ville était toute bâtie en briques.
On y voyait des tours, des bazars, des fabriques,
Des arcs, des palais pleins de luths mélodieux,
Et des monstres d’airain qu’on appelait les dieux.
Cette ville était gaie et barbare ; ses places
Faisaient par leurs gibets rire les populaces ;
On y chantait des chœurs pleins d’oubli, l’homme étant
L’ombre qui jette un souffle et qui dure un instant ;
De claires eaux luisaient au fond des avenues ;
Et les reines du roi se baignaient toutes nues
Dans les parcs où rôdaient des paons étoilés d’yeux ;
Les marteaux, au dormeur nonchalant odieux,
Sonnaient, de l’aube au soir, sur les noires enclumes ;
Les vautours se posaient, fouillant du bec leurs plumes,
Sur les temples, sans peur d’être chassés, sachant
Que l’idole féroce aime l’oiseau méchant ;
Le tigre est bien venu près de l’hydre ; et les aigles
Sentent qu’ils n’ont jamais enfreint aucunes règles,
Quand le sang coule auprès des autels radieux,
En venant partager le meurtre avec les dieux.
L’autel du temple était d’or pur, que rien ne souille,
Le toit était en cèdre et, de peur de la rouille,
Au lieu de clous avait des chevilles de bois.
Jour et nuit les clairons, les cistres, les hautbois,
De crainte que le Dieu farouche ne s’endorme,
Chantaient dans l’ombre. Ainsi vivait la ville énorme.
Les femmes y venaient pour s’y prostituer.
Mais un jour l’Océan se mit à remuer ;
Doucement, sans courroux, du côté de la ville
Il rongea les rochers et les dunes, tranquille,
Sans tumulte, sans chocs, sans efforts haletants,
Comme un grave ouvrier qui sait qu’il a le temps ;
Et lentement, ainsi qu’un mineur solitaire,
L’eau jamais immobile avançait sous la terre ;
C’est en vain que sur l’herbe un guetteur assidu
Eût collé son oreille, il n’eût rien entendu ;
L’eau creusait sans rumeur comme sans violence,
Et la ville faisait son bruit sur ce silence.
Si bien qu’un soir, à l’heure où tout semble frémir,
À l’heure où, se levant comme un sinistre émir,
Sirius apparaît, et sur l’horizon sombre
Donne un signal de marche aux étoiles sans nombre,
Les nuages qu’un vent l’un à l’autre rejoint
Et pousse, seuls oiseaux qui ne dormissent point,
La lune, le front blanc des monts, les pâles astres,
Virent soudain, maisons, dômes, arceaux, pilastres,
Toute la ville, ainsi qu’un rêve, en un instant,
Peuple, armée, et le roi qui buvait en chantant
Et qui n’eut pas le temps de se lever de table,
Crouler dans on ne sait quelle ombre épouvantable ;
Et pendant qu’à la fois, de la base au sommet,
Ce chaos de palais et de tours s’abîmait,
On entendit monter un murmure farouche,
Et l’on vit brusquement s’ouvrir comme une bouche
Un trou d’où jaillissait un jet d’écume amer,
Gouffre où la ville entrait et d’où sortait la mer.
Et tout s’évanouit ; rien ne resta que l’onde.
Maintenant on ne voit au loin que l’eau profonde
Par les vents remuée et seule sous les cieux.
Tel est l’ébranlement des flots mystérieux.
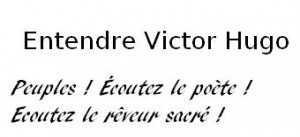











Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !