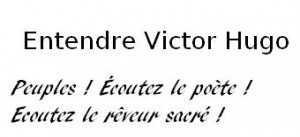I. L’an neuf de l’hégire
L’an neuf de l’hégire – Les références
La Légende des siècles – Première série – III – L’Islam ;
Collection Bouquins, Robert Laffont, Œuvres complètes de Victor Hugo – Poésie II, p 599.
Autre référence : Collection Poésie/Gallimard, La Légende des siècles, p. 148.
L’an neuf de l’hégire – L’enregistrement
Je vous invite à écouter L’an neuf de l’hégire, premier poème de la partie III – L’Islam, de La Légende des siècles – Première Série, de Victor Hugo.
Il est suivi du poème II. Mahomet.
L’an neuf de l’hégire
L’an neuf de l’hégire – Le texte
I
L’an neuf de l’hégire
Comme s’il pressentait que son heure était proche,
Grave, il ne faisait plus à personne un reproche ;
Il marchait en rendant aux passants leur salut ;
On le voyait vieillir chaque jour, quoiqu’il eût
À peine vingt poils blancs à sa barbe encor noire ;
Il s’arrêtait parfois pour voir les chameaux boire,
Se souvenant du temps qu’il était chamelier.
Il songeait longuement devant le saint pilier ;
Par moments, il faisait mettre une femme nue
Et la regardait, puis il contemplait la nue,
Et disait : « La beauté sur terre, au ciel le jour. »
Il semblait avoir vu l’Éden, l’âge d’amour,
Les temps antérieurs, l’ère immémoriale.
Il avait le front haut, la joue impériale,
Le sourcil chauve, l’œil profond et diligent,
Le cou pareil au col d’une amphore d’argent,
L’air d’un Noé qui sait le secret du déluge.
Si des hommes venaient le consulter, ce juge
Laissait l’un affirmer, l’autre rire et nier,
Écoutait en silence et parlait le dernier.
Sa bouche était toujours en train d’une prière ;
Il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre ;
Il s’occupait lui-même à traire ses brebis ;
Il s’asseyait à terre et cousait ses habits.
Il jeûnait plus longtemps qu’autrui les jours de jeûne,
Quoiqu’il perdît sa force et qu’il ne fût plus jeune.
À soixante-trois ans, une fièvre le prit.
Il relut le Koran de sa main même écrit,
Puis il remit au fils de Séid la bannière,
En lui disant : « Je touche à mon aube dernière,
Il n’est pas d’autre Dieu que Dieu. Combats pour lui. »
Et son œil, voilé d’ombre, avait ce morne ennui
D’un vieux aigle forcé d’abandonner son aire.
Il vint à la mosquée à son heure ordinaire,
Appuyé sur Ali, le peuple le suivant ;
Et l’étendard sacré se déployait au vent.
Là, pâle, il s’écria, se tournant vers la foule :
« Peuple, le jour s’éteint, l’homme passe et s’écoule ;
La poussière et la nuit, c’est nous. Dieu seul est grand.
Peuple, je suis l’aveugle et je suis l’ignorant.
Sans Dieu je serais vil plus que la bête immonde. »
Un scheik lui dit :« Ô chef des vrais croyants ! le monde,
Sitôt qu’il t’entendit, en ta parole crut ;
Le jour où tu naquis une étoile apparut,
Et trois tours du palais de Chosroès tombèrent. »
Lui, reprit : « Sur ma mort les anges délibèrent ;
L’heure arrive. Écoutez. Si j’ai de l’un de vous
Mal parlé, qu’il se lève, ô peuple, et devant tous
Qu’il m’insulte et m’outrage avant que je m’échappe ;
Si j’ai frappé quelqu’un, que celui-là me frappe. »
Et, tranquille, il tendit aux passants son bâton.
Une vieille, tondant la laine d’un mouton,
Assise sur un seuil, lui cria : « Dieu t’assiste ! »
Il semblait regarder quelque vision triste,
Et songeait ; tout à coup, pensif, il dit : « Voilà,
Vous tous : je suis un mot dans la bouche d’Allah ;
Je suis cendre comme homme et feu comme prophète.
J’ai complété d’Issa la lumière imparfaite.
Je suis la force, enfants ; Jésus fut la douceur.
Le soleil a toujours l’aube pour précurseur.
Jésus m’a précédé, mais il n’est pas la Cause.
Il est né d’une vierge aspirant une rose.
Moi, comme être vivant, retenez bien ceci,
Je ne suis qu’un limon par les vices noirci ;
J’ai de tous les péchés subi l’approche étrange ;
Ma chair a plus d’affront qu’un chemin n’a de fange,
Et mon corps par le mal est tout déshonoré ;
Ô vous tous, je serai bien vite dévoré
Si dans l’obscurité du cercueil solitaire
Chaque faute de l’homme engendre un ver de terre.
Fils, le damné renaît au fond du froid caveau,
Pour être par les vers dévoré de nouveau ;
Toujours sa chair revit, jusqu’à ce que la peine,
Finie, ouvre à son vol l’immensité sereine.
Fils, je suis le champ vil des sublimes combats,
Tantôt l’homme d’en haut, tantôt l’homme d’en bas,
Et le mal dans ma bouche avec le bien alterne
Comme dans le désert le sable et la citerne ;
Ce qui n’empêche pas que je n’aie, ô croyants !
Tenu tête dans l’ombre aux anges effrayants
Qui voudraient replonger l’homme dans les ténèbres ;
J’ai parfois dans mes poings tordu leurs bras funèbres ;
Souvent, comme Jacob, j’ai la nuit, pas à pas,
Lutté contre quelqu’un que je ne voyais pas ;
Mais les hommes surtout ont fait saigner ma vie ;
Ils ont jeté sur moi leur haine et leur envie,
Et, comme je sentais en moi la vérité,
Je les ai combattus, mais sans être irrité ;
Et, pendant le combat, je criais : « Laissez faire !
» Je suis seul, nu, sanglant, blessé ; je le préfère.
» Qu’ils frappent sur moi tous ! que tout leur soit permis !
» Quand même, se ruant sur moi, mes ennemis
» Auraient, pour m’attaquer dans cette voie étroite,
» Le soleil à leur gauche et la lune à leur droite,
» Ils ne me feraient point reculer ! » C’est ainsi
Qu’après avoir lutté quarante ans, me voici
Arrivé sur le bord de la tombe profonde,
Et j’ai devant moi Dieu, derrière moi le monde.
Quant à vous qui m’avez dans l’épreuve suivi,
Comme les Grecs Hermès et les Hébreux Lévi,
Vous avez bien souffert, mais vous verrez l’aurore.
Après la froide nuit, vous verrez l’aube éclore ;
Peuple, n’en doutez pas ; celui qui prodigua
Les lions aux ravins du Jebel-Kronnega,
Les perles à la mer et les astres à l’ombre,
Peut bien donner un peu de joie à l’homme sombre. »
Il ajouta : « Croyez, veillez ; courbez le front.
Ceux qui ne sont ni bons ni mauvais resteront
Sur le mur qui sépare Éden d’avec l’abîme,
Étant trop noirs pour Dieu, mais trop blancs pour le crime ;
Presque personne n’est assez pur de péchés
Pour ne pas mériter un châtiment ; tâchez,
En priant, que vos corps touchent partout la terre ;
L’enfer ne brûlera dans son fatal mystère
Que ce qui n’aura point touché la cendre, et Dieu
À qui baise la terre obscure, ouvre un ciel bleu ;
Soyez hospitaliers ; soyez saints ; soyez justes ;
Là-haut sont les fruits purs dans les arbres augustes,
Les chevaux sellés d’or, et, pour fuir aux sept cieux,
Les chars vivants ayant des foudres pour essieux ;
Chaque houri, sereine, incorruptible, heureuse,
Habite un pavillon fait d’une perle creuse ;
Le Gehennam attend les réprouvés ; malheur !
Ils auront des souliers de feu dont la chaleur
Fera bouillir leur tête ainsi qu’une chaudière.
La face des élus sera charmante et fière. »
Il s’arrêta, donnant audience à l’esprit.
Puis, poursuivant sa marche à pas lents, il reprit :
« Ô vivants ! je répète à tous que voici l’heure
Où je vais me cacher dans une autre demeure ;
Donc, hâtez-vous. Il faut, le moment est venu,
Que je sois dénoncé par ceux qui m’ont connu,
Et que, si j’ai des torts, on me crache au visage. »
La foule s’écartait muette à son passage.
Il se lava la barbe au puits d’Aboulféia.
Un homme réclama trois drachmes, qu’il paya,
Disant : « Mieux vaut payer ici que dans la tombe. »
L’œil du peuple était doux comme un œil de colombe
En regardant cet homme auguste, son appui ;
Tous pleuraient ; quand, plus tard, il fut rentré chez lui,
Beaucoup restèrent là sans fermer la paupière,
Et passèrent la nuit couchés sur une pierre.
Le lendemain matin, voyant l’aube arriver :
« Aboubèkre, dit-il, je ne puis me lever,
Tu vas prendre le livre et faire la prière. »
Et sa femme Aïscha se tenait en arrière ;
Il écoutait pendant qu’Aboubèkre lisait,
Et souvent à voix basse achevait le verset ;
Et l’on pleurait pendant qu’il priait de la sorte.
Et l’ange de la mort vers le soir à la porte
Apparut, demandant qu’on lui permît d’entrer.
« Qu’il entre. » On vit alors son regard s’éclairer
De la même clarté qu’au jour de sa naissance ;
Et l’ange lui dit : « Dieu désire ta présence.
— Bien, » dit-il. Un frisson sur ses tempes courut,
Un souffle ouvrit sa lèvre, et Mahomet mourut.